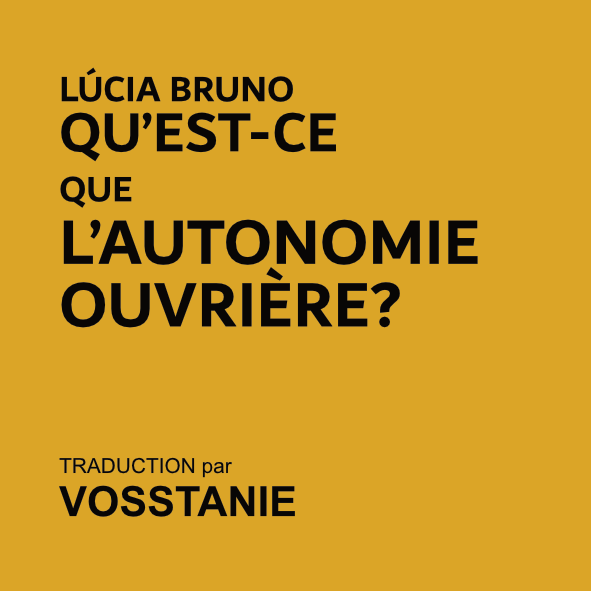Artiste: JORN Asger
Voici un texte qui avait été publié dans le journal anarchiste québécois Démanarchie en 1997!
Juste avant il y a mon humble résumé critique. Vos propres critiques sont plus que les bienvenues car il s’agit d’un projet à élaborer en collectivité si on aspire à le concrétiser! Il existe une panoplie de textes et d’expériences qui ont été créés sur le sujet que ça soit en France ou aux USA, ça vaudrait la peine de se pencher ensemble sur la question un jour dans les asso et syndicats!
L’article met au début l’accent sur la liberté légitime des élèves d’orienter les études et les méthodes d’éducation tout en critiquant la structure actuelle qui reproduisentt l’âgisme et poussent les élèves à intérioriser les dynamiques de domination capitaliste. Pour parvenir à une éducation libre, l’article suggère qu’il est possible d’autogérer son CÉGEP ou son pavillon universitaire par l’occupation de l’établissement et l’expulsion de la sécurité et de l’administration. Même si l’article dit qu’il n’offre pas de recette, ce qu’il propose reste critiquable. Selon moi, il aborde l’autogestion dans une perspective trop centrée sur la communauté étudiante. Il s’adresse donc à des étudiantEs en lutte. Pourtant, pour arriver à autogérer un établissement il est essentiel d’avoir non seulement l’aval des employéEs et des profs, mais d’avoir leur pleine participation.Le projet autogestionnaire en éducation est le résultat du travail de tous les travailleurs-travailleuses (intellectuel, manuel ou social) qui assurent son fonctionnement qu’on ne pourrait réduire à la liberté étudiante. En intégrant étudiantEs, employéEs et professeurEs, on peut de plus arriver à amener la liberté étudiante aux niveaux primaires et secondaires. Ceux-ci sont mis de côté dans l’article étant donné l’absence de conditions matérielles permettant l’auto-organisation. Dans tous les cas, l’autogestion dans les entreprises ont été un succès dans la mesure où les ouvriers et ouvrières ont pu vendre leurs produits pour assurer leur propre subsistance salariale. Si l’État refuse de subventionner une université ou un CÉGEP autogéré sur le long terme, les gens devront arriver soi à le pousser à le faire par une pression populaire massive ou à se lancer dans une campagne d’autofinancement massive.
Autogérer l’éducation : Pour libérer l’école de l’emprise du capital et enfin la mettre au service de la population. Journal anarchiste Démanarchie. 1997.
Il est possible, en tant qu’étudiante, qu’étudiant, d’emmener une perspective autogestionnaire dans notre milieu de vie. L’école, comme toute les institutions sociales, demande un réaménagement, des modifications majeures : plus que des réformes, il faut faire la révolution aussi dans nos cégeps et universités.
Cela demande une préparation, et évidemment la compréhension du système dans lequel on étudie. L’éducation, comme composante de la société, sert autant à apprendre une matière qu’une façon de vivre.
Si on voit facilement que l’éducation nous apporte des connaissances sur divers sujets, par l’enseignement, on oublie souvent qu’elle est un modèle qu’on tente de faire appendre aux gens qui la fréquente. Modèle d’obéissance, d’autorité, d’infantilisme.
Le dressage : apprendre l’autorité petit à petit
D’abord, l’école primaire remplace les parents à un stade du développement de l’enfant où il intériorise l’autorité. C’est le moment où la jeune personne va facilement accepter un modèle autoritaire. Pour les pédagogues et les éducateurs et éducatrices ayant le droit de citer (c-à-dire ceux et celles dont le programme est approuvé par le ministère de l’éducation), l’enfant est incapable de prendre par lui-même les décisions le concernant. L’école primaire remplace une relation parent/enfant où le jeune influence ses parents dans leurs choix par une relation maitre/élève fixée dans le béton, où les décisions n’émanent pas d’une discussion entre l’enseignant et l’enseigné, mais sortent de divers programmes établis par des technocrates.
C’est alors que se fait le passage à l’école secondaire. Il est un rituel d’entrée dans la vie. Il correspond d’ailleurs à la sortie de l’enfance et au début de l’adolescence. Du coup, les règles changent pour les jeunes. L’autorité ne disparaît pas, loin de là, c’est plutôt l’encadrement qui se fait plus diffus. Les responsabilités des jeunes augmentent, les mesures disciplinaires se raffinent, pour devenir moins paternalistes. C’est à ce moment que se fait l’apprentissage de l’état policier. C’est aussi l’école secondaire qui prépare les jeunes pour le travail. Ces deux caractéristiques sont marquantes dans la structure de l’école.
Puis, c’est au niveau collégial que l’élève voit son statu changer. Il gagne en autonomie, tout en perdant en encadrement. Loin de constituer une amélioration, le passage au niveau collégial ne fait que correspondre à une nouvelle préparation dans la vie des gens. On ne forme plus l’élève pour un travail machinal, simple et de base. Le cégep va former des gens plus spécialisés, plus autonomes.
L’université sera la continuité de ce processus. L’élève est devenu totalement autonome, il est plus apte à prendre des décisions. Mais comme dans les autres cas, la possibilité de décider se limite dans un cadre très strict imposé par le professeur, qui désire plus que les gens parlent de ce qui l’intéresse lui, que de ce que les élèves veulent vraiment.
L’âgisme à l’école
Dans aucun de ces cas, l’étudiante ou l’étudiante ne peut profiter réellement d’un pouvoir de décision. Tout est décidé de l’extérieur, par des gens qui sont plus ou moins concernés par l’éducation des autres. Ce qui intéresse les personnes qui prennent les décisions n’est d’ailleurs pas ou peu relié avec le contenu du programme : l’important est le contenant. Tant qu’on le remplit d’une matière à bon marché, le système d’éducation reste le cadre idéal pour véhiculer une idéologie autoritaire, basée sur la productivité. L’essentiel reste qu’il faut forcer les gens à intérioriser les fondements du capitalisme : soumission à l’autorité, recherche de profit, productivisme, etc.
Il s’agit aussi de faire une critique de l’âgisme, c’est-à-dire de ce qui fait que l’école est séparée selon les âges. D’abord, nous l’avons vu, l’éducation fait correspondre à chaque phase du développement ( on pourrait dire du sous-développement) de la personnalité, une période scolaire. L’école a adapté chacune de ses années scolaires pour faire apprendre une part de plus en plus importante du système autoritaire et productiviste capitaliste.
On tente d’abord de passer du rêve (de la maternelle de jeux à la première année du primaire productiviste et autoritariste). On va ensuite d’une réalité complexe, de plus en plus proche du système capitaliste (secondaire). Ensuite, on retourne à une éducation plus déconnectée de la réalité du travail, plus centrée sur les décisions, sur la compréhension de cette réalité en vue d’y interagir (comme c’est le cas au cégep et à l’université)
L’âgisme c’est d’abord de séparer les gens selon leur destination sur le marché du travail. De mésadapté (primaire), à ouvrier (secondaire), de spécialiste (cégep), à «décideur» (université), le système scolaire apprend les classes sociales, les expérimente, force leur acceptation. C’est d’autant plus vrai que les écoles de riches, les écoles privées, permettent souvent, dès le primaire, des activités parascolaires axées sur la détente, les loisirs, le sport et parfois même de constater la différence qu’il y a entre le mécanisme d’apprentissage du niveau public et l’apprentissage personnalisé du secteur privé. Le ratio prof élève ( de 25-30 par classe au public à 10-15 dans certaines écoles privées) le démontre bien.
L’âgisme c’est aussi une classification arbitraire des gens selon leur âge. Au lieu de séparer les gens selon leurs goûts pour tel ou tel type de matière (arts, sciences, langues, etc.), selon leur habilité en telle ou telle discipline, selon leur faculté d’apprendre de telle ou telle manière (certaines personnes comprennent mieux avec des exemples, d’autres préfèrent jouer et mimer pour mieux connaître leur sujet, etc.), on met tous les jeunes dans les mêmes classes, tout ce qui importe c’est leur âge.
Et le pire de tout, on normalise par rapport à cet âge. Comme une personne en secondaire 2 est censée connaître l’algèbre, elle redoublera jusqu’à ce qu’elle le sache. Et cela va entraîner un retard dans les autres matières, même si elles ne sont pas en rapport avec les mathématiques. Cette façon de faire st purement discriminatoire. D’abord, il est faux de penser que tout le monde devrait savoir une même matière au même âge. Ensuite, il est imbécile de retarder le développement global d’une personne pour un problème de compréhension d’une seule matière.
C’est là l’aspect pervers de l’âgisme : déterminer une norme qui doit être respectée selon l’âge. Cela va en parallèle avec le fait que les gens ne peuvent décider des fins que les gens ne peuvent décider des fins de leur éducation. C’est l’«hétérogestion» phénomène qui fait que les choses sont décidées par les dirigeants, par les décideurs technocrates du Ministère de l’Éducation, selon les besoins du système, et non selon les besoins des gens concernés. Les élèves se retrouvent à subir le système d’éducation au lieu de le vivre.
Autogérer l’école maintenant!
L’éducation libérée veut briser ces schémas oppressifs. L’autogestion apporte à l’éducation ce qui lui manque pour être vraiment utile à l’individu : la liberté d’apprendre ce qui nous intéresse, ainsi que le droit de choisir les fins et les moyens de cette éducation. Toutes ces choses nous sont refusées actuellement.
Nous devons donc nous organiser pour réussir à renverser la vapeur. Je ne parlerai pas (ou si peu) dans la partie qui va suivre, d’autogestion au primaire ou au secondaire. La complexité du développement humain fait qu’il faudrait s’étendre sur des particularités au niveau primaire. Par exemple, il est évident qu’une personne de huit ans n’a pas le bagage nécessaire pour gérer elle-même son éducation sans l’intervention d’une personne adulte. Il faudrait en plus une analyse distincte au niveau secondaire, notamment parce que les structures actuelles (associations étudiantes et périodes de libération de cours inexistants, lieux de rencontre restreints, présence obligatoire à tous les cours, etc.) demanderaient une lutte poussée et différemment structurée.
En d’autres mots, nous croyons réalisable, dans les prochains mois, un projet complet d’autogestion. Les associations étudiantes sont un bon moyen d’organiser cela.
Même si cette partie est moins théorique, il ne s’agit pas ici d’une recette. Nous allons exposer diverses solutions qui pourraient mener éventuellement à l’autogestion totale ou partielle des institutions d’enseignement, cégep ou université. Ce qui peut être fait dans un cégep au complet peut l’être dans un département universitaire de la même manière. Souvent, les départements jouissent d’une autonomie suffisante pour réaliser une partie importante du programme autogestionnaire proposé ici.
D’abord, l’élément le plus important de l’autogestion, c’est de connaître à fond les mécanismes de notre institution. Il convient de savoir qui prend réellement les décisions, qui est responsable de la gestion de la bâtisse, quel est le mode de paiement des professeurs et des employés, etc. Nous rappelons que l’autogestion consiste à reprendre le contrôle sur des choses qui devraient nous appartenir. Ne pas connaître ces choses et leur fonctionnement actuel serait impensable.
Il est probable que le premier acte posé par une assemblée générale qui a adopté l’autogestion comme moyen d’action sera de tenter d’occuper l’école (le cégep ou le pavillon universitaire). Il faut donc, minimalement, être en mesure de mettre l’administration dehors. Il est important d’informer les divers syndicats (professeurs, employé-e-s de soutient, etc.) afin de les aviser du fait que leurs patrons ne seront plus dans l’école. La phase de l’occupation demande une organisation technique importante, car il faut en tout temps surveiller les portes d’accès, pour éviter que l’administration et la sécurité retournent en poste.
L’occupation, c’est le premier pas vers l’autogestion : c’est le moyen de s’approprier les lieux physiquement. Le but des occupants sera probablement de tenter de gérer la bâtisse : accès à la bibliothèque, utilisation des gymnases hors des heures de classe, théâtre, etc. Les avantages seront évidents : ainsi, les ressources deviennent accessibles 24 heures par jour, sans restrictions. Il ne faut pas oublier que l’administration loue les gymnases et le théâtre après les heures de cours sous prétexte que les élèves n’ont ont plus besoin. C’est archifaux. À plusieurs reprises lors d’occupations de cégep, les gymnases ont été utilisés la nuit durant pour des activités sportives amusantes, hors du cadre scolaire strict. La salle de théâtre, l’improvisation, l’orchestre de l’école, où sont projetés les derniers films des étudiantes et étudiants en cinéma, etc.
Puis chose important lors d’une occupation, le cégep ou le pavillon occupé risque de changer de figure. Lors des grèves de 1996, le cégep de Lévis-Lauzon, occupé depuis plusieurs jours, fut «repeinturé» par des âmes artistiques. Les murs mornes furent alors transformés en véritables œuvres d’art, ce qui eut lieu de déplaire à la direction lorsqu’elle put revenir au cégep!
Un autre élément important des occupations est l’immense permissibilité due au fait qu’il n’y a plus de sécurité ni d’administration. Ainsi, plusieurs substances généralement interdites peuvent être consommées en toute tranquillité. Telle ou telle salle peut-être transformée en fumoir, en bar, etc. Même quelques coins déserts peuvent être propices à des ébats sexuels, normalement impossibles, ou presque 😉 , dans un cégep ou une université.
Tout est possible!
Il est important de rappeler que même si l’occupation est centrale dans l’autogestion, elle n’est pas l’élément essentiel. Il est davantage important d’avoir les outils pour décider des fins de son éducation. Nous entendons par là qu’il faut établir des instances démocratiques de décision sur tout ce qui concerne l’éducation, autant par rapport au contenu du cours que par la manière d’enseigner.
Il existe plusieurs façons de penser une éducation libre et autogérée. Certaines de ces façons ne peuvent pas être vécues en même temps, par une personne, mais de toute façon, elles peuvent être appliquées dans un même système d’éducation sans qu’elles soient contradictoires. La seule forme d’éducation qui entre en conflit avec les autres est celle que l’on connaît actuellement dans nos écoles!
Catégories :Autogestion, Étudiant-e-s, Lecture, Québec