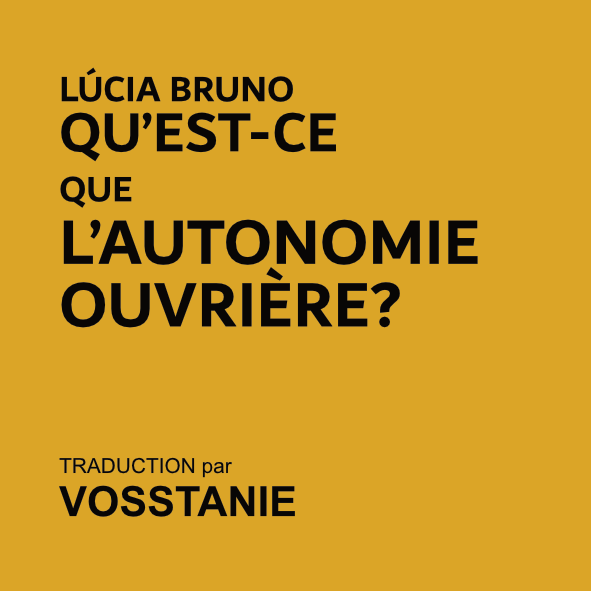AIT, l’internationale révolutionnaire inconnue
Conférence prononcée à Cologne (Allemagne) par le Secrétaire général de l’AIT, Fidal Gorron Canoyra, les 15 et 16 novembre 1986.
Traduite de l’espagnol par Liberté Ouvrière, 2022
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS, l’AIT actuelle, est non seulement le plus ancienne internationale syndicale existante, mais elle est considérée comme l’héritière directe de la Première Internationale fondée en 1866, principalement du courant anti-autoritaire et fédéraliste dont elle a tiré son nom.
La vérité est qu’il n’est pas facile de parler de l’AIT aujourd’hui. On sait peu de choses à son sujet et ce que l’on sait est intimement lié au développement du mouvement anarchiste international. Nous pouvons affirmer qu’elle a été la tentative la plus sérieuse des anarchistes d’approcher les masses laborieuses avec une stratégie spécifiquement libertaire.
Le Monde Libertaire, l’organe de la Fédération anarchiste de France, a rappelé dans un de ses derniers numéros que ce n’est pas tous les anarchistes qui y ont participé. En effet, c’est le cas du courant favorable au pluralisme syndicaliste et opposé à l’organisation des anarchistes, tel qu’ils se sont manifestés au congrès d’Amsterdam.
C’est pourquoi l’AIT est moins connue comme l’Internationale du syndicalisme révolutionnaire, ce qu’elle devrait vraiment être, que comme l’Internationale anarcho-syndicaliste ou l’Internationale anarchiste syndicaliste.
Nous disons aussi qu’il est difficile de parler de l’AIT, car les archives des premières années de l’AIT ont disparu à Berlin, où résidait le secrétariat général, avec l’arrivée du nazisme au pouvoir. Il est possible que certaines des sections fondatrices, comme le SAC et le FORA, conservent de la documentation de cette époque, mais pas le secrétariat.
La documentation ultérieure a également disparu en raison de la Seconde Guerre mondiale. La documentation existante sur cette période est dispersée au sein des différentes sections qui ont survécu sans constituer d’archives formelles. Je tiens à souligner l’énorme obstacle que les deux guerres mondiales ont représenté pour le développement de l’AIT tout au long de ses soixante-quatre années d’histoire.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’une vulgaire inconnue. L’AIT a été le moteur du mouvement anarcho-syndicaliste de notre époque, et son histoire est une histoire passionnée comme celle de toutes les organisations révolutionnaires qui ont laissé une profonde empreinte sociale.
C’est aussi l’histoire turbulente et tourmentée de l’Europe de l’entre-deux-guerres. Une histoire qui ne peut s’expliquer, et surtout se comprendre, qu’à travers le choc brutal de deux vagues opposées : la vague révolutionnaire née de la révolution russe et la vague autoritaire du signe fasciste qui, depuis l’Italie, a inondé toute l’Europe dans les années trente.
En effet, l’AIT a été contrainte d’associer la lutte pour l’émancipation des travailleurs à la lutte contre le fascisme que la social-démocratie et les communistes avaient perdu politiquement. La conquête des 36 heures par semaine par la CNT espagnole en juin 1936 et la lutte sanglante contre le fascisme des anarchistes italiens, bulgares, allemands et espagnols, en sont un exemple.
Une double lutte que l’AIT a payée au prix fort. Peut-être que ce qui illustre le mieux la situation entre de l’AIT d’aujourd’hui est la tragédie de la famille anarchiste Muhsam. Le poète Muhsam du Soviet de Bavière a été assassiné par les nazis en juillet 1934 et sa compagne Zensl Muhsam a disparu dans les prisons soviétiques en 1939 alors qu’elle s’était réfugiée en Russie pour chercher de l’aide contre le fascisme.
Pour une meilleure compréhension, nous avons divisé l’histoire de l’AIT en quatre périodes significatives, que nous allons brièvement commenter :
– La première va de ses origines à sa fondation. C’est la période de l’agitation sociale.
– La seconde va de sa fondation à la guerre civile espagnole. C’est ce que nous appellerons la période révolutionnaire.
– Le troisième est l’AIT et la guerre civile espagnole. C’est le baptême de feu de l’AIT.
– La quatrième et dernière période, de 1951 à 1986. L’ère de la reconstruction.
1º – Agitation sociale
La nécessité d’une Internationale syndicaliste révolutionnaire a commencé à se faire sentir à la fin du siècle dernier, après la fin définitive de la Première Internationale en 1877. Douze ans plus tard, les syndicalistes réformistes créent leur propre internationale, celle d’Amsterdam, connue sous le nom de IIe internationale, qui disparaît, victime de ses contradictions, après la Première Guerre mondiale.
C’est au début de ce siècle que s’officialisent les premiers syndicats révolutionnaires et anarcho-syndicalistes, comme l’IWW nord-américain et la FORA argentin. En Europe, pour n’en citer que quelques-uns, l’USI italienne, la SAC suédois et les fédérations industrielles de Hollande; la CNT espagnole ne fut fondée qu’en 1910.
Ainsi, ce n’est qu’en 1913 à Londres que les syndicats révolutionnaires purent tenir leur premier congrès en septembre de la même année, avec la participation des syndicats allemands de la FVDG, de la SAC suédois, de la COB brésilienne, de la FORA argentine, de l’USI italienne et des délégués de plusieurs syndicats français, belges, espagnols et anglais (1).
Ce même Congrès syndical international fixe déjà les principes de la future AIT en se déclarant en faveur de la lutte des classes jusqu’à la réalisation de la socialisation de la propriété, de la solidarité internationale et de la libre association des travailleurs visant à l’abolition du système capitaliste et de l’État. La lutte se fera dans le domaine économique et par l’action directe.
Au cours de ce même congrès de Londres, il a été décidé de convoquer une nouvelle réunion l’année suivante, mais celle-ci n’a pu avoir lieu en raison de la Première Guerre mondiale. Le Secrétariat national du travail de Hollande a envoyé une circulaire à tous les syndicats participants pour un nouveau congrès à la fin de la guerre, qui n’a pas non plus pu avoir lieu parce que les gouvernements de Hollande, de Suède et du Danemark l’ont empêché à chaque fois.
Mais c’est aussi l’époque de la révolution russe, cet immense feu de joie qui a embrasé le monde et allait réduire en cendres les projets de la future Internationale du syndicalisme révolutionnaire, l’AIT actuelle, même si plus tard le rejet du centralisme soviétique par les syndicalistes révolutionnaires a été le plus grand stimulant pour la fondation de l’AIT.
En effet, certains des grands syndicats qui allaient finalement constituer la colonne vertébrale de la future AIT se déclaraient sympathisants de la IIIe Internationale, l’Internationale syndicale rouge de Moscou. Parmi eux, l’USI, la CNT espagnole, certains syndicats français et certains courants de la FORA (2).
En 1920, lors du passage de délégations de syndicats révolutionnaires de divers pays à Berlin, venus assister au congrès fondateur de l’Internationale Syndicale Rouge, s’est tenu aussi un congrès précipité qui donna naissance à l’Internationale révolutionnaire du Travail au beau milieu de débats violents entre les différentes positions (3).
En réalité, les accords de ce congrès n’étaient qu’un pacte transitoire entre les syndicats révolutionnaires, pacte limité au fait d’être toutes les délégations présentes au congrès de Moscou. À leur retour de Russie, les délégués, déçus de voir que la réalité soviétique ne répondait pas aux espoirs placés dans la révolution, se réunirent à Dusseldorf pour convoquer une conférence plus importante l’année suivante à Berlin.
La Conférence Syndicaliste Révolutionnaire s’est tenue, comme prévu, à Berlin en 1921 et a réuni des délégations de tous les pays européens, y compris des délégués des syndicats soviétiques officiels et des minorités syndicalistes révolutionnaires russes (4).
Les sessions de la Conférence ont duré quatre jours et au cours de la deuxième journée, les délégués des syndicats soviétiques ont violemment quitté la réunion lorsque la Conférence a adopté une résolution des minorités syndicalistes révolutionnaires russes condamnant les persécutions des travailleurs révolutionnaires dans tous les pays, en particulier en URSS.
La Conférence a convenu, entre autres, de tenir un congrès constitutionnel de la nouvelle internationale à la fin de la même année à Berlin. Il a également été décidé de rompre les relations avec les deux internationales syndicales marxistes : l’internationale syndicale réformiste d’Amsterdam et l’Internationale Syndicale Rouge de Moscou.
La nouvelle Internationale du Syndicalisme Révolutionnaire serait de type anarchiste, indépendante de tous les partis politiques, révolutionnaire et fédéraliste ; capable de regrouper tous les travailleurs pour transformer la société. Surtout, la nouvelle internationale ferait la promotion d’un courant syndicaliste différent de ceux de la IIe et de la IIIe internationale.
La Conférence a également lancé un appel à la solidarité en faveur des compagnons italiens de l’USI qui luttaient désespérément contre le fascisme dans leur pays. Une lutte parallèle à celle des syndicalistes et anarchistes révolutionnaires russes contre les communistes russes après qu’ils aient détruit les conseils ouvriers de la Révolution.
Désormais, parallèlement aux luttes pour l’émancipation de la classe ouvrière contre la bourgeoisie et le capitalisme, les syndicalistes révolutionnaires devaient également lutter contre le fascisme et le communisme international.
Enfin, au mois de décembre de cette même année 1922, le congrès constitutif de l’AIT se tient à Berlin, ses séances durent jusqu’au 2 janvier et sont clandestines et entravées par la police. Il a réuni sept délégations au début et s’est terminé avec dix. La délégation espagnole, retenue à Paris par la police, est arrivée à la fin (5).
Le congrès fondateur a adopté la déclaration de principes du syndicalisme révolutionnaire approuvée lors de la précédente conférence en juin, à laquelle il a ajouté un préambule avec une analyse de la situation actuelle dans le monde dénonçant l’offensive du capitalisme contre les travailleurs et la déviation de la révolution sociale par les communistes russes, ce qui justifie la nécessité d’une nouvelle internationale révolutionnaire.
Sur le plan des principes, le syndicalisme révolutionnaire reconnaît la lutte des classes et aspire à la réorganisation de la société sur la base du communisme libre. La double tâche du syndicalisme révolutionnaire consiste dans la lutte quotidienne pour l’émancipation économique et sociale de la classe ouvrière dans la société actuelle, et dans l’élévation des masses à la direction de l’administration de la production et de la distribution des biens de consommation, en remplacement de la domination des partis politiques et des groupes dominants.
Les méthodes de lutte du syndicalisme révolutionnaire sont l’action directe, la grève générale, le boycott et la solidarité entre les travailleurs. Les structures de la société future seront le fédéralisme libertaire et le libre accord, étant entendu que le syndicalisme révolutionnaire n’est qu’un moyen pour mettre fin au capitalisme, mais jamais une fin.
Pour cette raison, le syndicalisme révolutionnaire s’oppose à l’État et à l’Église pour leur centralisme autoritaire qui limite la liberté des individus, et rejette le parlementarisme et la collaboration avec les institutions législatives. De même, il se déclare antimilitariste à la fois contre l’existence des armées et contre la fabrication de matériel de guerre de toute sorte.
Fondamentalement, le syndicalisme révolutionnaire se déclare internationaliste et rejette toutes les frontières, car il considère que les nationalismes sont la cause des États et des guerres, ainsi que de l’exploitation des travailleurs. Les peuples, comme les individus, doivent être libres de déterminer avec qui ils s’associent sans contrainte historique, éthique, religieuse ou politique. Éthique, religieuse ou politique.
Comme nous l’avons dit, le Congrès constitutif fut clôturé le 2 janvier 1923, et la nouvelle Internationale du syndicalisme révolutionnaire récupéra le nom d’Association Internationale des Travailleurs (AIT) en mémoire de la Première Internationale qui avait commencé la lutte pour l’émancipation sociale.
2º – La période révolutionnaire
Depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui, l’AIT a tenu 17 congrès internationaux, dont le dernier à Madrid en 1984, où a été nommé l’actuel secrétaire général. La période que nous allons commenter se termine avec le IVe Congrès de l’AIT à Paris en 1938 avec le débat historique sur la guerre civile espagnole.
Le 2e congrès de l’AIT (6) s’est tenu en mars 1925, à Amsterdam. Deux ans auparavant, l’AIT avait tenu une importante session plénière internationale à Innsbruck (Autriche) à laquelle participaient sept délégations et où furent à nouveau soulevés le problème des relations avec les autres internationales ouvrières, les avancées du fascisme et la ratification de l’entrée des sections dans l’AIT.
En ce qui concerne les progrès du fascisme, le Secrétariat général a fait état des mesures prises avec les deux autres internationales ouvrières pour protester contre l’occupation du bassin de la Rhur par les troupes alliées et le manque d’intérêt du Parti communiste allemand pour combattre le fascisme avec l’aide des travailleurs.
Les deux internationales syndicales, l’Internationale socialiste d’Amsterdam et l’Internationale Syndicale Rouge de Moscou, n’ont pas répondu à l’appel de l’AIT et le plénum a convenu de rejeter les slogans de front unique lancés par les communistes puisqu’ils n’avaient pour intention que de diriger le mouvement ouvrier international et de contrôler le syndicalisme révolutionnaire.
Les rapports des délégués des sections sont dramatiques : le fascisme progresse partout, et ce ne sont plus seulement l’Italie et l’Allemagne qui sont menacées, mais aussi la Bulgarie, l’Espagne et la Turquie qui commencent à ressentir les effets de la répression sanglante des dictatures militaires.
A cette époque, les sections d’Europe du Nord de l’AIT connaissent une croissance régulière. La NSF norvégienne compte cinquante-deux groupes locaux et deux fédérations industrielles ; la SAC suédoise, 30 000 membres. La FAU allemande compte 520 groupes et 120 000 membres ; son journal tire à 50 000 exemplaires par semaine.
Mais comme nous l’avons dit, le IIe congrès s’est tenu à Amsterdam en mars 1925. Les 12 sections qui formaient l’AIT étaient présentes, dont trois du continent américain. Une délégation du Brésil était également présente en tant qu’observateur. A cette époque, l’AIT publiait déjà trois périodiques en différentes langues et une revue d’études sociales en allemand (7).
Le rapport du Secrétariat général confirme la consolidation de l’Internationale, malgré la dure répression dans la plupart des pays, même par les bolcheviks russes. Le syndicalisme révolutionnaire anime les courants anti-autoritaires du mouvement ouvrier avec une force imparable.
Comme thèmes du congrès, une motion fut débattue sur les partis politiques, dont il fallait déraciner le monopole qu’ils exerçaient sur les travailleurs et reconquérir la liberté de presse, d’expression et d’association, conquêtes des révolutions précédentes. Dans les pays où les syndicats sont illégaux, la lutte doit être menée dans les milieux de travail.
En outre, indépendamment de la lutte contre le fascisme, le congrès encourage les travailleurs à lutter pour des améliorations économiques immédiates, car de telles luttes favorisent l’avancée de la révolution. Le congrès a accepté la formation de fédérations internationales d’industrie pour internationaliser la lutte contre le capital et organiser la solidarité ouvrière.
Le IIIe Congrès s’est tenu à Liège, en Belgique, en mai 1928. Comme cela était obligatoire, une Plénière s’était d’abord tenue à Paris, en 1926, pour examiner la situation de certaines Sections en exil et dans la clandestinité, comme l’USI, la CNT espagnole, les Bulgares, les Portugais où leurs militants étaient assassinés et emprisonnés par le fascisme.
Les persécutions de l’AIT ont motivé le congrès à étudier la nécessité de créer un fonds de solidarité pour les persécutés de tous les pays. Douze délégations et de nombreux représentants de syndicats boliviens, chiliens, paraguayens, chinois et japonais y participent (8).
Dans le domaine économique, le congrès dénonce les nouvelles formes d’exploitation du capital, parmi lesquelles la rationalisation du travail et son développement financier et industriel dans des cartels et trusts internationaux qui deviendront les multinationales d’aujourd’hui.
Face à l’offensive capitaliste, le congrès propose la réduction de la journée de travail à 6 heures de travail et la nécessaire augmentation des salaires pour maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs. De la même manière, il met en garde contre les concessions du capitalisme, comme les 8 heures du Traité de Washington. Signé par la plupart des gouvernements qui ont affaibli le mouvement ouvrier.
Le congrès a suggéré aux travailleurs de ne pas être dogmatiques dans leurs principes afin de pouvoir avancer parallèlement aux avancées du progrès et de d’adapter leurs méthodes de lutte aux exigences du moment. Nous devons être flexibles et capables de nous adapter aux circonstances sans abandonner les principes du syndicalisme révolutionnaire. Le capitalisme international doit être combattu par des actions internationales, sur le terrain même de ses principes.
Enfin, le IIIe Congrès approuve la motion contre le militarisme et la fabrication de matériel de guerre et appelle toutes les organisations idéologiquement proches à s’unir dans la lutte révolutionnaire.
Le IVe Congrès de l’AIT a eu lieu à Madrid en juin 1931 après le renversement de la dictature militaire du général Primo de Rivera et la proclamation de la République, ce qui a permis à la CNT espagnole de retrouver la légalité, avec près d’un million de membres.
La participation des délégués était nombreuse. Aux sections reconnues par l’AIT, s’ajoutent celles de l’ACAT américaine fondée en 1929, une variété considérable de représentants de groupes anarchistes de tous pays et de syndicats indépendants (9).
A ce congrès a lieu la présentation officielle de l’ACAT, Association continentale américaine des travailleurs, affiliée à l’AIT, qui regroupe 13 centrales syndicalistes révolutionnaires, dont sept sont représentées au congrès par leur propre délégation.
Le rapport du secrétaire général a laissé transparaitre la croissance de l’AIT par l’ajout de nouvelles sections en Roumanie, en Bulgarie et en Pologne. La dissolution de la FORA par le gouvernement argentin, a eu des répercussions négatives sur le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Amérique latine.
D’autre part, la CNT espagnole a resurgie, puissante et menaçante sur le plan révolutionnaire. Elle a été également persécutée par la nouvelle République qui a remplacé la dictature militaire. Dans d’autres sections, la situation était difficile, comme la FAUD, dont 90% de ses membres étaient sans travail. C’est l’Europe affamée du fascisme.
L’analyse de la situation ouvre la porte au débat sur les nouvelles formes de production. Les nouvelles techniques doivent être accueillies par les travailleurs, car le progrès industriel est révolutionnaire s’il est dépouillé de ses aspects répressifs. Ce qu’il faut obtenir, c’est que les techniques ne profitent pas seulement au capitalisme et ne servent pas à exploiter davantage la classe ouvrière.
Le congrès a également adopté plusieurs résolutions sur la réforme agraire et la crise économique, qui ne sera pas résolue tant que la transformation du système capitaliste ne sera pas complète, et a encouragé l’augmentation des salaires par l’action directe sans concession à aucun pouvoir politique ou corporatif.
De même, le congrès approuve une résolution antimilitariste et contre la fabrication de matériel de guerre, précisant les mesures à prendre pour empêcher sa production et son transport, pour lutter contre la conscription des travailleurs.
Aussi, et dans le cadre de l’analyse de la situation, le congrès dénonce la pénétration des idées nationalistes dans la classe ouvrière en raison de la misère croissante, qui précipite les tensions militaires et sociales. Car le fascisme n’est pas seulement la prise du pouvoir par les droites réactionnaires, c’est aussi la guerre.
Le Vème congrès se tient à Paris en août 1935, après une série d’événements décisifs pour l’AIT. C’est une période terrible. L’affrontement des deux vagues, la révolutionnaire et la fasciste, s’annonce brutal… c’est le début d’une guerre de survie sans quartier.
À l’irrésistible montée du fascisme en Europe, qui n’hésite pas à écraser les travailleurs à coups de canon comme dans le cas des socialistes autrichiens à Vienne, les anarcho-syndicalistes espagnols répondent par une série de grèves et de mouvements révolutionnaires qui sont passés à l’histoire sous le nom des « trois-huit ».
C’est exact. Le 18 janvier 1932, les mineurs du haut Llobregat déclarèrent une grève générale et, telle une marée révolutionnaire, implantèrent le communisme libertaire dans de nombreuses villes catalanes. La grève révolutionnaire atteint également l’Andalousie et le conflit dure près d’une semaine. La répression du gouvernement républicain est dure et une centaine d’anarcho-syndicalistes de la CNT se voit déportée vers les colonies africaines.
Un an plus tard, les anarcho-syndicalistes espagnols se jetèrent à nouveau dans la lutte et, dans plus de cinquante villes et villages du pays, proclamèrent le communisme libertaire, ne serait-ce que pour quelques heures ou quelques jours. C’était le 8 janvier 1933.
A la fin de la même année, le 8 décembre, la CNT lance un nouveau mouvement insurrectionnel qui est noyé dans le sang par le gouvernement républicain. La ville de Villanueva de la Serena en Estrémadure, où le communisme libertaire s’est implanté, comme dans d’autres villes de la région, est prise d’assaut par les forces de La Garde civile.
A partir de ce moment, l’avenir du mouvement révolutionnaire mondial est lié au succès ou l’échec des anarcho-syndicalistes espagnols. C’est-à-dire de l’AIT, car la CNT était son rempart révolutionnaire en Europe. Le point de rencontre des deux vagues, comme on le verra plus tard, était l’Espagne.
Pendant cette période violente, l’AIT a tenu d’importantes sessions plénières internationales avant le Vème Congrès. La première a lieu en avril 1932, où est élu le nouveau Secrétariat de l’AIT, qui s’installe à nouveau à Berlin.
Mais l’AIT n’y reste pas longtemps. En janvier 1933, Hitler arrive au pouvoir et, après l’incendie du Reichstag, la persécution se déchaîne contre les partis politiques et les organisations de travailleurs. La police fasciste s’empare des locaux de l’AIT et saisit ses archives. Le Secrétariat général dû quitter l’Allemagne.
Le deuxième Plénum international s’est tenu à Amsterdam, en Hollande, où le Secrétariat général a été établi pour plus de sécurité. Une grande partie du Plénum a été consacrée au débat sur la perte des archives qui mettaient en danger les Sections et les militants de l’Internationale.
Dans ce Plénum, l’Union fédérale syndicaliste belge rejoint l’AIT. Ensuite, la situation en Europe est analysée face aux avancées du fascisme, considérant que les Sections ont déjà des milliers de militants dans la clandestinité ou en exil. Les possibilités de survie dans l’Espagne révolutionnaire face à l’Europe fasciste ou sociale-démocrate sont également analysées.
Mais au sein de l’AIT, un autre danger avait été créé. La CNT elle-même, en dépit de son révolutionnarisme avéré, subissait les conséquences d’une profonde scission provoquée par les approches réformistes du groupe dit trentista qui préférait la collaboration à la confrontation sociale.
C’est le même problème que celui que la FORA argentine traîne depuis dix ans avec ses affrontements entre deux tendances syndicalistes et qui, à terme, deviendra le talon d’Achille du syndicalisme révolutionnaire.
Le troisième Plénum international, avant le Cinquième Congrès, se tient également à Madrid, où le Secrétariat général s’était installé en novembre 1933. Cependant, les activités révolutionnaires de la CNT, qui un mois plus tard, comme nous l’avons vu, lance un autre mouvement insurrectionnel, créent des problèmes pour le développement du Secrétariat général.
De plus, en Espagne, un an à peine s’était écoulé depuis la révolution socialiste d’octobre dans le bassin minier des Asturies et celle des séparatistes catalans. Le climat était donc à la répression, mais aussi à l’exaltation révolutionnaire.
Au Plenum, la possibilité que l’AIT joigne la campagne des fronts uniques (ou populaires) organisée par la 3e Internationale communiste contre le fascisme a été étudiée, mais laissée de côté en perspective d’un référendum au sein des Sections à ce sujet.
Lors du référendum, l’AIT a refusé de rejoindre les fronts uniques parce qu’elle avait compris que la lutte contre le fascisme impliquait également la lutte contre l’État. Parce que s’allier avec les partis politiques et les démocraties signifiait renforcer le système démocratique des capitalistes qu’elle combattait également.
Erreur stratégique ou non, c’est le même problème qui devait accabler la CNT espagnole pendant la guerre civile : faire la révolution ou gagner la guerre contre le fascisme. La question a initié une polémique dans les milieux révolutionnaires et divisé tragiquement le mouvement anarchiste international.
Enfin, le Vème Congrès (10) de l’AIT s’est tenu à Paris en août 1935. Lors de ce Congrès, un nouveau Secrétariat général est élu, qui résidera à Amsterdam. La préoccupation majeure du Congrès est la menace de guerre qui pèse sur l’Europe.
Mais lors de ce Congrès, comme lors des sessions plénières précédentes, les délégués insistent sur le fait que la lutte contre le fascisme doit être menée non pas en fonction des intérêts de la bourgeoisie, mais en fonction des intérêts de la révolution sociale. Ce qui implique une vision différente de la question « démocratie ou fascisme ». L’AIT adhère plutôt à une vision de « révolution sociale ou fascisme ».
Un document sur le syndicalisme révolutionnaire et sa riposte aux avancées du capitalisme dans le domaine économique est discuté, mais non adopté. Le congrès se termine par un message aux victimes de la répression, tant fasciste que soviétique, et des gouvernements libéraux et démocratiques assoiffés du monde.
Nous pouvons conclure ici la deuxième période de l’histoire de l’AIT actuel.
3º – Baptême de feu
On peut dire que la troisième période commence dans les premiers jours de 1936 et se termine avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, alors que l’AIT a pratiquement été balayée de la scène sociale par les événements militaires et ne survit officiellement qu’en Suède ainsi que dans la volonté de centaines d’anarcho-syndicalistes exilés dans le monde entier.
Cette période peut être considérée comme celle du baptême de feu de l’AIT, et aussi celle de la confusion idéologique. À l’aide de la guerre, les courants réformistes et possibilistes prospèrent au sein du syndicalisme mondial comme alternatives pour collaborer à la lutte contre le fascisme et reconstruire les pays détruits par la guerre.
Il est clair que le premier grand événement à se produire dans les affaires de l’AIT est le Congrès extraordinaire de la CNT espagnole à Saragosse, au mois de mai 1936. Ce congrès qui eut lieu au milieu de fortes tensions sociales dans le pays (grèves, confrontations) peut être considéré comme le détonateur de la guerre civile espagnole.
Pendant douze jours, des milliers d’anarcho-syndicalistes se sont réunis à Saragosse pour débattre des problèmes de la future révolution et du remplacement du système capitaliste par le communisme libertaire; cela effraie la réaction.
Bien que cela n’ait peut-être jamais été suffisamment mis de l’avant, la chose la plus importante du Congrès est la réunification des deux courants qui divisaient la CNT, ainsi que la foi dans le triomphe d’une révolution qui était considérée comme presque à portée de main.
Le congrès, comme nous l’avons dit, s’est tenu en mai, coïncidant avec l’anniversaire des événements de Chicago, un événement important pour l’AIT. Deux mois plus tard, en juillet, avait lieu le soulèvement militaire soutenu par le fascisme international, qui donnait lieu à la guerre civile et à la révolution sociale des anarcho-syndicalistes de l’AIT.
Nous ne dirons rien de la guerre civile espagnole, sauf ce qui la lie à la révolution et à l’AIT, car des millions de pages ont été écrites sur la guerre civile et ce n’est pas le sujet de cette conférence.
La révolution anarcho-syndicaliste ou anarchiste espagnole, comme certains auteurs aiment à l’appeler, fut la conséquence non seulement du projet révolutionnaire formulé au congrès de Saragosse, mais surtout de la nécessité d’une réponse urgente à la situation créée par le soulèvement militaire qui paralysait la vie économique du pays.
Il est possible de se poser la question à savoir si les militaires ne s’étaient pas soulevés, si le processus révolutionnaire avait été possible. Au fur et à mesure que le soulèvement était maté dans les grandes zones industrielles et urbaines et dans les grandes zones paysannes, où prédominaient les organisations politiques et syndicales antifascistes, la vie sociale était réorganisée sur une base différente et c’est en cela que consistait la révolution.
La révolution a été anarchiste pour deux raisons : parce que la CNT était l’organisation la plus forte du pays, avec les idées les plus claires sur ce qu’il fallait faire dans une telle situation, et parce que les autres organisations n’étaient pas capables de réagir aux nécessités de la circonstance et ne le faisaient que lorsque les militaires avaient déjà été arrêtés.
C’est pourquoi il y a également eu une contre-révolution dans la zone républicaine pendant la guerre et les anarcho-syndicalistes de la CNT ont dû se battre sur deux fronts : contre le fascisme sur les champs de bataille et contre le gouvernement de coalition bourgeois antifasciste afin de sauver les conquêtes révolutionnaires.
La révolution a consisté en la socialisation du commerce, des transports et des industries dans les grandes villes, ainsi qu’en la collectivisation des campagnes dans des centaines de villages à une échelle qui n’avait jamais été atteinte auparavant dans aucun pays.
Au cours de la révolution, il y a eu des succès et des erreurs, surtout parce qu’en trente-six mois on ne peut pas changer la vie d’un pays, et encore moins en temps de guerre. Il a cependant été démontré que les travailleurs pouvaient organiser la société sans classes et sans méthodes autoritaires. Ce fut le grand triomphe moral et la leçon historique que les anarchistes espagnols ont laissés au monde entier.
Je vais répéter ici ce que m’ont dit de vieux paysans lorsque, après la dictature de Franco, je suis allé donner une conférence dans un village de La Mancha où la CNT avait maintenu une collectivisation prospère pendant toute la guerre : « nous n’avons pas collectivisé la richesse puis qu’il n’y en avait pas dans le village, nous avons socialisé des conditions de vie décentes pour tous avec l’effort de tous ».
L’élan révolutionnaire des anarcho-syndicalistes espagnols dura trois mois, jusqu’à ce qu’en novembre ils acceptent de participer au gouvernement. Mais les collectivités et les socialisations se sont maintenues tout au long de la guerre en surmontant les obstacles des circonstances et les pressions violentes du gouvernement et des partis petits-bourgeois, principalement les communistes, qui cherchaient à les détruire.
Cependant, paradoxalement, la plus grande critique des réalisations révolutionnaires provenait du Secrétariat général lui-même. Initiant du fait un débat idéologique qui dure encore et qui a débordé la sphère anarchiste internationale.
En novembre 1936, cinq mois après le début de la guerre civile, et alors que la CNT collaborait déjà avec le gouvernement, l’AIT se réunit. Le rapport du secrétaire général de l’époque, qui avait effectué trois voyages en Espagne, était négatif à l’égard des anarcho-syndicalistes espagnols.
Pour le Secrétariat général, la révolution avait stagné et, à certains égards, reculait sous la pression du gouvernement. Les collectivités et les municipalités libres nées de la révolution furent soumises à une politique priorisant la victoire de la guerre. Cette politique découlait des changements dans les opérations militaires et de l’attitude des dirigeants anarcho-syndicalistes.
Le débat en plénière a été divisé en deux camps. D’une part, ceux qui soutenaient les justifications et comportements de la CNT, parmi lesquels se trouvaient les Sections du Nord et les exilés des pays fascistes ; et d’autre part, les radicaux qui exigeaient de la CNT un retour à l’orthodoxie révolutionnaire (11).
Les délégués espagnols justifièrent la participation de la CNT au gouvernement et la militarisation parce qu’ainsi elle réussit à contrôler la situation et évita que les brigades confédérales soient commandées par des officiers qui lui sont étrangers. La même chose s’est produite dans le domaine économique en ce qui concerne le travail élaboré par les syndicats.
Le plénum a approuvé une résolution favorable à la CNT considérant que la lutte en Espagne faisait partie de la bataille générale contre le fascisme au niveau international. L’AIT s’engage alors à soutenir la lutte des anarcho-syndicalistes espagnols avec tous les moyens à sa disposition. Une autre résolution a également été adoptée pour dénoncer le gouvernement soviétique à la suite de la disparition de Zebl Müsham dans les prisons russes.
En juin 1937, un autre plénum de l’AIT se tient sur le thème de la révolution espagnole. Le Secrétariat général maintient sa critique de la CNT et critique ses dirigeants de ne pas avoir fait de la révolte anarchiste de mai 1937 à Barcelone un autre 19 juillet qui aurait rendu à la CNT le contrôle de la révolution au lieu d’apaiser les autres forces politiques.
En plus du rapport du Secrétaire général, le délégué suédois de l’AIT, dans son rapport, déclare que la guerre civile espagnole a mis en évidence certains problèmes du mouvement anarchiste international jamais connus dans la pratique et constate que les Sections de l’AIT devront étudier les enseignements de la révolution.
La CNT, selon le délégué de la SAC, avait accepté toute une série de responsabilités politiques avec lesquelles elle n’était pas d’accord avant la guerre. Comme la CNT avait compris que dans une révolution il doit y avoir un pouvoir public, surtout dans un pays où les anarchistes n’étaient pas seuls.
Le délégué suédois se prononce en faveur d’une collaboration politique avec tous les partis sans trop se compromettre dans le futur, en sacrifiant certains aspects révolutionnaires. C’était une offre de rénovation, non seulement de la stratégie révolutionnaire de l’AIT, mais aussi de sa philosophie idéologique.
Pour sa part, la CNT répond aux critiques des sections radicales de l’AIT en demandant leur compréhension. Elle explique que la CNT a sauté pratiquement de la clandestinité à la révolution alors que tous ses syndicats étaient affaiblis par le gouvernement républicain. Puisque la CNT a été la première à répondre au soulèvement militaire.
De plus, la CNT n’était pas seule en Espagne face au fascisme. Il y avait aussi l’UGT qui est une centrale syndicale puissante, bien que moins combative, et il y avait aussi les socialistes. Les petits partis républicains, dans leur ensemble, étaient également forts ; ils furent rejoints par les communistes pour défendre la bourgeoisie.
Il y avait aussi les démocraties européennes qui craignaient à la fois le fascisme et la révolution anarchiste et qui imposaient comme condition que la lutte des anarchistes contre le fascisme ne dépasse pas les limites du régime républicain établi de manière électorale.
Il est même question d’un débarquement de troupes anglaises et françaises en Catalogne pour mettre fin à la révolution anarchiste et faciliter la fin de la guerre civile.
Trois raisons justifiaient le projet d’un débarquement arbitraire visant à liquider la révolution anarchiste : la volonté des démocraties d’arrêter le fascisme allemand sur la base de concessions, qui a culminé dans le honteux pacte de Munich de septembre 1938 avec la reddition du territoire du sud-est à Hitler.
La seconde était la menace que représentait pour les intérêts britanniques et français l’existence d’une nation révolutionnaire à cheval sur la route commerciale la plus stratégique du monde, la Méditerranée, et surtout, alors qu’à l’autre bout de la mer, le nationalisme arabe représentait également un autre danger.
La troisième raison était la crainte du triomphe de la révolution anarcho-syndicaliste en Espagne et de son extension à toute l’Europe, qui serait prise au piège par l’emprise des communistes au Nord et des anarchistes au Sud.
Enfin, disaient les délégués espagnols, la révolte de Barcelone a éclaté parce que les compagnons de l’organisation catalane ne pouvaient plus résister aux pressions du gouvernement autonome de la Generalitat ni aux provocations des socialistes et des communistes qui, à l’époque, exterminaient l’aile trotskyste du POUM.
La plénière internationale de l’AIT, une fois de plus, a ratifié son soutien à la section espagnole dans sa lutte contre le fascisme. Une brève revue du reste des sections de l’AIT a été faite et la situation a été résumée comme suit : en Amérique latine, presque toutes les sections de l’ACAT étaient rendues clandestines à cause des dictatures militaires.
En Europe, à l’exception des Sections française, néerlandaise, suédoise et norvégienne, toutes les autres avaient disparu face à l’avancée du fascisme, à l’exception de la Section espagnole, qui luttait ouvertement sur les champs de bataille avec des chances inégales et peu de compréhension de la part du prolétariat mondial.
L’AIT convoqua encore un congrès extraordinaire pour traiter du problème de la guerre civile espagnole, mais ce sera le dernier de cette troisième période, car l’AIT ne se réunira à nouveau que quinze ans plus tard. C’est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, alors que le fascisme avait déjà disparu militairement.
Le Congrès extraordinaire a lieu à Paris, au mois de décembre 1937, et donne lieu à une confrontation entre la CNT espagnole et le Secrétariat général de l’AIT, comme lors des sessions plénières précédentes, en raison des déviations subies par les compagnons espagnols dans la révolution (12).
Un autre des sujets discutés était l’attitude de la SAC à l’égard de l’AIT, puisque celle-ci n’avait pas accepté les critiques de l’Internationale face à la situation en Espagne et avait suspendu son aide à la CNT et rompu ses relations avec le Secrétariat. La SAC ne partageait pas les thèses des autres Sections sur la révolution espagnole.
Le Secrétariat général accusa à nouveau la CNT de céder aux intérêts de la bourgeoisie, ce qui mettait en péril l’unité du prolétariat mondial. La confusion créée par la collaboration de la CNT avec le gouvernement était trop grave et le Secrétariat général demanda sa radiation de l’Internationale, entre autres parce qu’elle n’avait pas respecté les principes de l’AIT et qu’elle n’avait pratiquement pas cotisé malgré sa croissance.
La réponse de la CNT fut de demander aux sections de remplacer le secrétaire général par un autre ayant une vision plus large des choses et moins dogmatique. A la fin du Congrès, le secrétaire général sera remplacé par un nouveau secrétaire qui résida en Espagne, car l’AIT n’avait pas la force de s’opposer à la CNT.
Le congrès extraordinaire, le VIe de l’AIT, dura dix jours et, outre la polémique entre le Secrétariat général et la CNT, il fut question de la solidarité avec l’Espagne et de l’aide internationale. Malgré l’importance de la guerre civile espagnole, le prolétariat mondial se montra peu sensible à sa cause, comme il ne l’avait pas fait non plus avec les révolutionnaires allemands lors de la montée du fascisme.
L’AIT a présenté un plan de collaboration aux deux autres Internationales syndicales marxistes dans l’objectif de boycotter les transports mondiaux de marchandises des pays fascistes, en guise d’aide au peuple espagnol. Plan que les autres Internationales n’ont pas accepté.
D’un autre côté, les anarchistes ne disposaient pas des masses dans les pays encore libres pour pouvoir entraîner les travailleurs dans un soutien inconditionnel à la révolution espagnole, ce qui limitait les activités de l’AIT et ses efforts dans la lutte.
La fin de la guerre d’Espagne avec la victoire du franquisme et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale vont contraindre le secrétaire général de l’AIT à déménager de nouveau. Cette fois ce sera elle sera en Suède, où elle restera pour une longue période. Pendant cette période l’AIT restera en état d’hibernation forcée, contrainte par les circonstances qui traversent le monde.
4º – La reconstruction
Le VIIe congrès de l’AIT s’est tenu près de quinze ans après le précédent et, à ce moment-là, non seulement l’AIT, mais aussi le monde entier avait changé avec la défaite du fascisme sur les champs de bataille et l’émergence de nouvelles nationalités et de nouveaux problèmes sociaux face auxquels la faible AIT resta en marge.
Cela ne signifie pas pour autant que l’AIT soit absente des problèmes de son temps. Le Secrétariat général résidait en Suède et dans une circulaire d’août 1944, il annonçait le retour du FORA à la clandestinité comme conséquence du coup d’État militaire connu sous le nom de « mouvement des colonels » qui anticipait le fascisme de Perón.
Une autre circulaire en octobre de la même année parlait des persécutions des anarchistes en Pologne et de leur internement dans les camps de concentration soviétiques, car dès qu’ils eurent été libérés des nazis, ils furent à nouveau persécutés par les communistes russes, au mépris de leur collaboration et leur lutte dans la résistance au côté des Juifs contre les troupes allemandes de l’occupation.
Enfin, en cette même année 1944, dans une autre circulaire datée de décembre à Stockholm, le Secrétariat général alertait les travailleurs du monde entier sur le sens réel de la guerre qui venait de se terminer dans des termes très durs pour les Alliés.
Les troupes alliées, disait la circulaire, prétendaient se battre pour la démocratie, mais elles pensaient à une démocratie capitaliste. La mission des troupes alliées n’était pas seulement de détruire le fascisme, mais aussi d’empêcher la lutte des travailleurs pour leur émancipation économique et leur liberté.
Les troupes alliées dans les pays libérés du fascisme protégèrent les intérêts de la bourgeoisie de la même manière que des régimes fascistes comme celui de Franco, du moment que cela servait leurs intérêts. Les Alliés désarmaient les groupes armés des mouvements populaires qui luttaient contre le fascisme sous le prétexte de la fin de la résistance, mais en réalité, leur objectif était d’empêcher les tentatives révolutionnaires comme en 1917.
A la fin de la guerre – rappelons que la circulaire est datée de décembre 1944 – la lutte de la classe ouvrière devrait reprendre pour obtenir de nouvelles conquêtes révolutionnaires sans concessions à la bourgeoisie ni au capitalisme.
Dans une circulaire ultérieure, datée de mai 1945, il dénonce un télégramme de Staline au Pape dans lequel il déclare que l’URSS ne tenterait pas de changer l’ordre social existant, mais, au contraire, s’opposerait à tout changement révolutionnaire dans le monde.
Une dénonciation qui sera confirmée par une circulaire dramatique un an plus tard, en mai 1946, parlant de la répression des groupes anarchistes en Bulgarie par les nouveaux dirigeants communistes au service de l’URSS, qui n’hésitaient pas à fusiller les anarchistes en les accusant d’être des traîtres et des alliés du capitalisme.
Comme on le verra, les anarcho-syndicalistes n’avaient pas tout à fait tort lorsque, dans leur analyse de la lutte contre le fascisme lors des congrès qui ont précédé la guerre civile espagnole, ils excluaient les alliances avec la bourgeoisie et les communistes. Car les démocraties capitalistes, les communistes et l’Église catholique partageaient les mêmes objectifs.
L’important est que, si les sections de l’AIT ont disparu dans les dédales de la guerre, ses militants arrachés par milliers de leurs pays d’origine comme les Espagnols et les Bulgares, et d’autres qui, comme les Italiens, y sont revenus après de longues années d’exil, elles n’ont pas perdu le sens révolutionnaire de sa mission qui, comme un cordon ombilical, les reliaient au passé et aux origines de leurs luttes.
Ce qui est clair, c’est que la Seconde Guerre mondiale a été le triomphe du capitalisme sur toutes les autres forces sociales qui, sous l’illusion de combattre le fascisme, sont intervenues dans la guerre. C’est pourquoi on a tant insisté pour neutraliser la vague révolutionnaire des années précédentes, à commencer par la révolution anarchiste espagnole.
Les guerres de libération ultérieures n’ont pas été révolutionnaires puisqu’elles avaient renforcé le pouvoir de l’État et des bourgeoisies nationales en tant que groupes dominants dans ces pays. Elles ont dénaturalisé le concept de révolution sociale en substituant l’émancipation des travailleurs à la montée en puissance de groupes politiques au service des oligarchies financières.
En mai 1946, il y eut à Stockholm une conférence pour essayer de reconstruire l’AIT, dont nous n’avons guère de référence, mais qui servit à reprendre les relations interrompues par la guerre mondiale avec tous les groupes anarcho-syndicalistes du monde.
Le VIIe Congrès s’est tenu à Toulouse à la mi-mai 1951, et bien qu’il ait été organisé par la CNT française, l’impulsion est venue des milliers d’anarcho-syndicalistes espagnols exilés dans le monde entier et parfaitement organisés en noyaux fédérés de la CNT – AIT.
Le congrès avait comme rôle de relancer l’AIT dans la nouvelle ère, mais passa ses séances à débattre au sujet de ses relations avec la CNT espagnole, qui à l’époque traversait une autre scission importante entre dans la clandestinité et l’exil qui a duré six ans.
Une scission qui transcendait d’une certaine manière l’ensemble de l’AIT, la divisant en deux interprétations sur la légitimité des délégations présentes. En réalité, quelque chose de plus profond était débattu : si la collaboration avec les autres forces antifascistes ayant combattu pendant la guerre était terminée ou, au contraire, s’il fallait la continuer, au même titre que la collaboration avec les institutions républicaines en exil pendant que le franquisme restait au pouvoir.
Un autre thème central du congrès est le réformisme de la SAC et son acceptation des projets patronaux et gouvernementaux suédois pour sortir de la crise économique, ce qui l’éloignait des principes de l’AIT. La SAC cherchait à obtenir une réforme des statuts afin de leur permettre de collaborer avec l’État et de se présenter aux élections municipales ; il faisait même certaines concessions au militarisme.
La discussion sur les principes et tactiques de l’AIT et la volonté de réformer les statuts ont fortement passionné le Congrès. Le rejet de la collaboration avec l’État et l’orthodoxie idéologique dominait le congrès, comme lors du débat sur l’Espagne, mais la SAC avait introduit en lui la graine du réformisme.
Quatorze délégations représentant l’AIT étaient présentes au VIIe Congrès, avec une majorité de pays européens et deux délégations américaines, l’argentine et la cubaine. La Suède a été à nouveau élue comme résidence du Secrétariat général (13).
Le VIIIe Congrès a eu lieu deux ans plus tard, également en France, à Puteaux, en juillet 1953. Un total de 20 délégations d’Europe et d’Amérique ont participé à ce congrès, dont le point culminant a été l’approbation de la résolution sur le cas dit de l’Espagne (14).
Cette résolution mettait fin au débat ouvert sur la collaboration de la CNT à la guerre civile et considérait comme dépassée la situation créée par celle-ci. La période collaborationniste était terminée et la CNT revenait à son orthodoxie anarcho-syndicaliste caractéristique.
Mais le plus grave, c’est que la scission au sein de la CNT restait ouverte et qu’il fallut encore près de dix ans pour réaliser l’union des deux tendances. Une union très fragile qui se brisera à nouveau trois ans plus tard, donnant lieu à une longue série de séparations qui perdurent encore. Le schisme de la collaboration et le travail clandestin de la SAC avaient eu des effets négatifs sur l’anarcho-syndicalisme espagnol.
Le rapport des sections au Congrès est clairement positif quant à son rétablissement, mais l’AIT est loin d’être ce qui l’avait porté à la tête du mouvement ouvrier révolutionnaire mondial. Elle n’a pas encore trouvé sa place dans la nouvelle situation mondiale d’après-guerre.
Enfin, le VIIe Congrès accepta la démission du secrétaire général, de la section suédoise, qui était à la tête de l’AIT depuis quinze ans et élit un camarade français pour le remplacer. C’était la première fois qu’une femme représentait l’Internationale, créant ainsi un précédent dans l’histoire de la révolution.
A partir de ce Congrès (15), les autres se succèdent assez régulièrement, le tout conformément aux statuts de l’AIT. Le IXe Congrès eut lieu également en France, à Marseille, en juillet 1956. Ce qui ne changeait pas, c’était le ton des débats sur le réformisme.
Ainsi, le rapport du secrétaire général dénonçait les activités de la section suédoise favorables au collaborationnisme, et s’immisçant dans la vie des autres sections. La gravité de l’affaire est que la SAC entraînait d’autres sections dans ses projets, comme la section néerlandaise, où elle a trouvé un appui.
C’est aussi la première fois que les compagnons danois assistaient à un congrès de l’AIT avec leur propre représentation, la délégation danoise avait sérieusement accusé les Suédois de manœuvres sournoises pour imposer leurs vues à l’AIT. La SAC, disaient les Danois, avait changé ses principes et voulait forcer les autres à la suivre contre leur gré.
La réaction des Sections contre la SAC était unanime. L’AIT était peut-être une Internationale faible à cette époque, mais cela ne justifiait pas qu’elle se laisse entraîner par le courant réformiste qui dominait le mouvement ouvrier et qui, au sein de l’AIT, était représenté par la SAC.
Aux arguments de la SAC et des Néerlandais en faveur du réformisme et de la stratégie possibiliste, les délégués répondaient en rappelant que ni le possibilisme de Kropotkine, ni la trahison de la IIe Internationale socialiste n’ont favorisé en quoi que ce soit le mouvement ouvrier et ont au contraire facilité la montée du fascisme et du communisme autoritaire.
Mais si les congrès précédents étaient des débats sur les principes de l’AIT, le 10e congrès, tenu en août 1958, était celui de la rupture avec la SAC. Dix sections différentes de l’AIT participaient à ce congrès. Le congrès se déroulait à Toulouse.
Ce 10e congrès réanalysait les activités collaborationnistes de la SAC, notamment dans ses activités municipalistes et ses caisses de chômage qui la liait à l’État. On comprenait ses difficultés à se développer dans la société suédoise, mais ses complots contre l’AIT n’étaient pas tolérés (16).
Dans les débats sur la SAC, les sections considéraient que si la SAC ne respectait pas les principes de l’AIT, elle s’excluait elle-même de l’Internationale. L’intention n’était pas d’expulser la SAC, mais de lui faire clarifier sa position au sein de l’anarcho-syndicalisme.
La fin du débat sur la section suédoise aboutit à une résolution du Congrès dans laquelle il était contraint d’accepter une mise à l’écart de la SAC, l’une des sections fondatrices de l’AIT dans les années 20. Les délégués de la SAC déploraient le manque de vision de l’AIT face aux problèmes actuels et quittèrent le Congrès.
Afin d’éviter de futures déviations dans l’Internationale, le Congrès approuva une motion de la FORA dans laquelle il était établi que seuls les groupes qui acceptaient le communisme libertaire, mieux encore le communisme anarchique, et les principes du fédéralisme comme leur but pouvaient être admis dans l’AIT.
A la fin, le congrès élabora un document visant à renforcer l’AIT, et un camarade de la CNT espagnole en exil fut nommé secrétaire général. Le secrétaire général continua à résider en France.
Nous manquons de documentation sur le XIe Congrès, mais il s’est tenu en 1961 en France, et y étaient présents les délégués suédois et néerlandais qui avaient quitté l’AIT, mais ils n’avaient pas rectifié leurs positions ni reconsidéré leur désaffiliation. Ceci n’est pas surprenant après la radicalisation du Xème Congrès sur le communisme libertaire.
Le XIIe Congrès se tient également en France, à Puteaux, entre fin octobre et début novembre 1963. Lors de ce congrès, le point le plus pertinent est le débat sur les relations avec les autres Internationales syndicales par certaines sections en dehors de l’AIT (17).
Un autre problème étudié était celui des relations difficiles entre certaines fédérations anarchistes et les sections de l’AIT comme dans le cas de la Fédération Anarchiste de France avec la CNT française, et de la FAU uruguayenne avec la FORU. L’AIT souffrait de la crise de l’anarchisme organisé dans sa nouvelle phase.
Un autre problème également considéré était la pétition adressée au Congrès par plusieurs associations argentines qui demandaient d’être reconnues comme membres de l’AIT en dehors de la FORA. L’existence de trois courants différents au sein du FORA produisait une grande confusion au sein du Congrès lors des discussions.
En ce qui concerne les relations avec les autres Internationales, on reprochait à la CNT espagnole en exil son manque de respect des statuts de l’AIT en raison de ses engagements avec des syndicats réformistes internationaux et avec des organisations sous la protection du Vatican.
L’accord de l’Alianza Sindical avec des organisations affiliées aux Internationales comme la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC), tant opposés à l’AIT, ne rentre pas dans l’analyse des sections. Il y a trente ans, l’Alianza Sindical existait déjà en Espagne en tant que projet révolutionnaire, mais aujourd’hui elle est perçue comme une manœuvre de l’Internationale socialiste et de l’Église pour faciliter la sortie du franquisme.
Le XIIIe Congrès de l’AIT eu lieu à Bordeaux, en novembre 1967. Dix sections, américaines et européennes, étaient présentes : la section argentine continuait à présenter trois représentations comme au Congrès précédent. Dans la FORA s’était produit un phénomène de désagrégation commun aux grands syndicats touchés par le réformisme (18).
Les travaux de ce congrès sont pour la plupart constructifs. De nouvelles positions sur l’économie, le coopérativisme et le collectivisme, et sur la manière de rendre la propagande de l’AIT plus pratique sont étudiés. Le congrès se termine par un débat sur la situation argentine et un nouveau secrétaire général, qui résidera également en France, est désigné parmi les exilés espagnols.
Avant d’aller plus loin, nous dirons qu’entre les deux derniers congrès, en 1961, la CNT espagnole met fin à la scission après 17 ans d’affrontements entre les deux courants opposés. L’exil et l’intérieur pour la première fois depuis la guerre civile marchent ensemble et le résultat est l’intensification de la lutte contre le franquisme où la CNT paie un tribut sanglant.
Le XIVe Congrès s’est tenu à Montpellier en octobre 1971 et a réuni dix délégations. Comme le précédent, c’est un congrès plutôt constructif, même si le problème de FORA assombrit les séances. Le groupe d’amis de l’AIT vénézuélien devient une section sous le nom de FORVE (19).
Le congrès fait une étude sur l’implantation de l’AIT dans les pays sous-développés et définit l’autogestion révolutionnaire, qui dans la guerre civile espagnole était appelée collectivisation et socialisation. Ce sont des formules qui doivent être transférées à la société d’aujourd’hui dans le cadre de la lutte révolutionnaire.
Et comme nous le disons, le numéro de FORA ne clarifie guère la situation. Fondamentalement, il s’agit du même problème que celui dont souffrent les syndicats de l’AIT à l’époque actuelle lorsqu’ils sont confrontés aux complexes législations du travail imposées par la social-démocratie. Il s’agit de la lutte contre l’influence du réformisme dans le mouvement ouvrier.
Le XVe Congrès garde le même ton que les deux précédents. C’est un Congrès prolifique en résolutions sur les problèmes actuels du monde : les guerres nationalistes et les soi-disant luttes de libération ; le retour des dictatures dans les pays sous-développés, la société de consommation, la croissance démographique et la faim, la pollution de l’environnement…
Les compagnons allemands du groupe de Cologne assistent à ce Congrès pour la première fois en tant qu’observateurs après une absence de l’AIT de plus de quarante ans. Malheureusement, la plupart des sections sont absentes pour diverses raisons. Il s’agit d’un Congrès minoritaire. Il s’est tenu à Paris en avril 1976 (20).
A l’époque de ce Congrès, l’AIT traversait un mauvais moment. Les sections uruguayenne et norvégienne donnent à peine des signes de vie, et l’USI italienne est en période de reconstruction. Le côté positif est la présence des Allemands, qui ont joué un rôle si important dans l’histoire de l’AIT, ainsi que la demande d’adhésion des compagnons danois et les contacts avec des groupes d’anarcho-syndicalistes suédois en dehors de la SAC qui souhaitaient formaliser leur adhésion.
Les compagnons portugais de l’Alianza Anarco-sindicalista désirant formaliser leur adhésion assistèrent aussi au congrès. Ceux-ci informe le congrès de leurs relations avec la SAC et de leur présence au Congrès de Stockholm où ils ont pu observer le grand intérêt des jeunes pour l’AIT.
Une analyse sereine de la situation de l’AIT nous permet d’affirmer que l’Internationale se redresse lentement, malgré l’expansion sociale-démocrate dans les pays européens qui ont démobilisé le mouvement ouvrier en l’intégrant comme une institution de plus dans les mécanismes de l’État.
Le XVIe congrès de l’AIT a également eu lieu en France, à Paris, en avril 1976. C’est le plus positif des plus récents congrès de l’AIT et les raisons pour cela ne manquent pas. De nouvelles sections ont été incorporées et ce qui stimule le travail du Congrès.
Comme nous le disions, la présence des nouvelles sections est le point fort du Congrès. Il y a trois nouvelles délégations et deux ont été récupérées depuis le Congrès précédent, comme la norvégienne et l’italienne, qui avaient traversé une grave crise de consolidation (21).
Parmi les nouveaux visages, on trouve les Allemands, les Américains du LWG des États-Unis, qui sera la première section nord-américaine de l’AIT dans son histoire actuelle, et les Australiens de l’Industrial Workers. Tous ces groupes seront déjà des sections de l’AIT lors du prochain congrès.
Dans ce Congrès, la section espagnole, après avoir été représentée pendant de nombreuses années par l’organisation exilée de la CNT, est remplacée par la délégation espagnole, car cela fait six mois que la dictature militaire de Franco a disparu et que la CNT a retrouvé la légalité.
C’est une substitution qualitative, très significative, qui va changer la tradition de l’AIT dans son développement habituel. Le travail de survie des compagnons espagnols exilés a été difficile et on peut affirmer que leur dévouement presque fanatique à l’association a sauvé l’AIT.
Il est clair que l’AIT est une organisation en pleine expansion. De cinq sections au XIVe Congrès, elle est passée à dix au XVIe, certaines d’entre elles n’ayant jamais appartenu à l’AIT auparavant. L’USI, maintenant rétablie, est devenue une organisation nationale et les groupes suédois sont considérés comme une future alternative à la SAC.
Cependant, il y a un débat entre les délégués anarchistes italiens au congrès en tant qu’observateurs et la représentation de l’USI, sur la légitimité de l’USI en tant que section de l’AIT, que le congrès résout en ne reconnaissant aucune autre centrale syndicale italienne comme membre de l’Internationale que l’USI.
Sur la question des relations avec les autres organisations anarchistes, plus précisément avec la Comisión de Relaciones Internacionales de las Federaciones Anarquistas (CRIFA), le congrès est sans appel : « nous reconnaissons l’affinité idéologique de la CRIFA avec l’AIT – dit le congrès -, mais les organisations sont autonomes ».
Le CRIFA et l’AIT peuvent développer ensemble des problèmes concrets, en gardant toujours à l’esprit que le CRIFA est une organisation spécifiquement anarchiste et l’AIT une organisation de travailleurs.
Le Congrès est favorable au maintien des relations avec toutes les organisations apparentées et avec celles du syndicalisme révolutionnaire, même si elles ne se considèrent pas comme anarcho-syndicalistes, telles que la SAC, l’IWW américaine et l’OVB néerlandaise. L’ASO danoise est provisoirement admise comme section jusqu’au prochain Congrès.
Sur le point des positions révolutionnaires et de l’attitude de l’AIT face aux actions du terrorisme international de gauche et de droite, le Congrès statue que les soi-disant gauchistes ne sont pas des révolutionnaires, mais le produit de la répression étatique et du système autoritaire actuel.
Une autre chose est que ces terroristes prétendent représenter les travailleurs dont ils sont isolés. Le terrorisme de droite est celui organisé par le fascisme international contre le mouvement ouvrier à l’aide de la collaboration des États, de la police et de l’armée, et financé par le capitalisme.
Il existe d’autres formes de terrorisme, le terrorisme nationaliste, avec de profondes racines religieuses catholiques ou musulmanes fondamentalistes, qui utilisent la misère du peuple comme justification morale de leurs actes violents, mais qui ne sont pas non plus véritablement révolutionnaires.
Les nouvelles technologies, les avancées des multinationales et la situation créée par celles-ci dans les relations de travail, ainsi que la grande crise économique résultant de l’augmentation du prix des produits pétroliers, sont également analysées par le Congrès.
Une autre nouveauté de ce Congrès est la composition du nouveau Secrétariat général, qui était jusqu’alors composé de délégués de différentes sections et dont une seule section assumera dorénavant la responsabilité. Le nouveau Secrétariat sera issu de la section espagnole, avec résidence à Madrid, et sera composé de cinq membres : Secrétaire général, Organisation, Archives, Propagande et Administration.
Le plus récent congrès de l’Internationale, le XVIIe, s’est tenu à Madrid, rompant avec une longue tradition de trente-trois ans de réunion en France pour des raisons connues de tous. Le Congrès avait un air de fraicheur, et l’AIT s’exprimait en anglais.
Dans ce congrès sont déjà représentées les 12 sections qui composent l’AIT actuel et certaines de celles qui seront intégrées dans un court laps de temps. Le congrès a eu lieu en avril 1984 et les sessions ont duré quatre jours (22).
La nouveauté du XVIIe Congrès, ce sont les compagnons japonais de la WSM, nouvelle section de l’AIT, bien que les Japonais militaient depuis longtemps autour de l’Internationale. Il en est de même pour les Australiens, mais leur entrée est en attente du prochain Congrès.
Depuis le précédent congrès, l’ASF est incorporée à l’AIT en tant que nouvelle section, en attendant une ratification. L’important est que l’AIT se développait avec un esprit ouvert aux problèmes de l’époque actuelle. Le problème de la situation en Amérique latine, ainsi que celui de la Pologne, préoccupait le congrès.
Ainsi, plusieurs résolutions importantes ont été votées en analysant la situation mondiale et les tensions créées par les deux impérialismes militaires qui se sont partagé l’hégémonie dans deux zones d’influence. Mais l’impérialisme a beaucoup à voir avec l’expansion du capitalisme sous toutes ses formes.
Quant au chômage, qui dans le monde atteint des proportions dramatiques, le Congrès affirme que dans le système capitaliste il n’y a pas de solution au problème. Comme méthode de lutte, les travailleurs doivent exiger la semaine de 35 heures avec le maintien du pouvoir d’achat nécessaire pour faire face à la situation.
Mais c’est peut-être dans la résolution antimilitariste et dans la condamnation de l’énergie nucléaire comme cause de destruction que le Congrès met le plus l’accent. L’AIT condamne les blocs militaires impérialistes et exalte la désobéissance civile face au service militaire et la désertion en cas de guerre. Le nouveau Secrétariat général tombe à nouveau entre les mains de la section espagnole.
Depuis le XVIIe Congrès, deux sessions plénières internationales de l’AIT ont eu lieu : l’une à Paris (23) en septembre 1985 et l’autre à Turin, en Italie, en juin 1986. Lors de la première, la crise mondiale du syndicalisme réformiste a été traitée et la situation créée au sein de la CNT espagnole par une nouvelle scission promue par un secteur réformiste a été étudiée.
Au plénum de Turin (24), un seul thème a été abordé : l’avancée des multinationales et la nécessité d’alternatives internationales pour les combattre. Parce que le problème des multinationales est avant tout une lutte entre exploités et exploiteurs sous d’autres formes, mais la même lutte comme toujours.
Et maintenant, quelques mots pour terminer : est-ce l’heure de l’AIT, l’heure du syndicalisme révolutionnaire ? Je pense que c’est à nouveau sa grande chance. L’échec du syndicalisme réformiste dans la crise économique actuelle et les approches de l’économie de marché font renaître des pratiques syndicalistes que l’on croyait dépassées.
Les millions de chômeurs dans les pays industriels et l’émergence de l’économie noire ou souterraine sont une conséquence des nouvelles approches capitalistes, mais aussi de l’échec du syndicalisme réformiste et de la politique économique de la social-démocratie dans tous les pays.
L’annonce de la fermeture de onze usine de General Motors aux États-Unis avec un licenciement de trente mille travailleurs ces jours-ci et l’effondrement de l’immobilier Neue Heimat des syndicats du DGB sont également des aspects de cet échec du syndicalisme réformiste dont nous parlons.
Nous n’allons pas dire que les approches de l’AIT sont la seule alternative à la situation actuelle, mais nous allons essayer de continuer à le démontrer. Rien de plus chers compagnons.
Cologne (RFA) 15 et 16 novembre 1986
Catégories :AIT, Anarcho-syndicalisme, Conférence, Espagne, Europe, Histoire, Révolution, Texte