Luís Andrés Edo
Espagne, 1984
Traduit de l’espagnol par Héloisa CASTELLANOS
Read in English here: Redefining Syndicalism (1984)
1. Définition de l’anarchosyndicalisme
Le discours anarchiste, en soutien de l’option syndicale, a offert des éléments d’une valeur indéniable pour les luttes du mouvement ouvrier. La formulation et la diffusion des modèles anarchistes d’action et d’organisation (l’action directe, l’autonomie, le principe fédéraliste, l’assembléisme, etc.) sont des apports de l’anarchisme militant, développés au sein des courants ouvriers révolutionnaires.
Ces apports, repris par le phénomène structural du syndicalisme, ont été appliqués en de multiples occasions, en accord avec les contenus anarchistes, malgré les évidentes difficultés inhérentes à toute transposition de la théorie à la pratique.
C’est un fait rigoureusement exact; cependant, l’impuissance manifeste de l’organisation anarchosyndicaliste à traduire ces apports dans les faits sans violenter ses contenus anarchistes n’est pas moins vraie. Ce problème est à tel point réel que, constamment, à l’intérieur de la structure syndicale, un phénomène de « redéfinition » des apports anarchistes se déchaîne, avec la tendance à les dénaturer et à limiter leur projection au seul sillon normatif de l’organisation.
À plusieurs reprises, au sein même de la structure anarchosyndicaliste ont été diffusées des formules dénaturées telles que « syndicat de classe, syndicalisme autosuffisant », qui sont en claire et flagrante contradiction avec les idées anarchistes.
Si ces deux formules l’emportaient, la structure anarchosyndicaliste deviendrait l’élément exclusif de la révolution anarchiste. Et si la réalisation de cette révolution sans la participation des organisations anarchosyndicalistes est impensable, il n’en est pas moins vrai que cette révolution ne pourra pas non plus se réaliser sans la participation de tous les secteurs sociaux qui, en marge de l’option syndicale, œuvrent pour la réalisation des objectifs libertaires. Si les tendances qui défendent l’autonomie de l’organisation face au système tombent dans cette « redéfinition » adultérante créée par les structures, le phénomène d’adultération devient encore plus grave lorsque la «redéfinition» est formulée par ces autres tendances prêtes à accepter l’institutionnalisation de l’anarchosyndicalisme, comme c’est le cas actuellement en Espagne où des militants reconnus, au long passé anarchiste, contaminés par une espèce de plaie (le « syndrome institutionnel » qui dévaste la société civile espagnole) défendent l’institutionnalisation de la CNT; alors la « redéfinition » atteint une adultération inacceptable.
Une réflexion sereine sur toutes ces contradictions nous conduit à soupçonner que toute définition limite la perspective et que toute structure tend à une « redéfinition » achevée, définitive, exclusive et fermée.
En résumant, nous disons que la structure syndicaliste recueille les apports d’action et d’organisation anarchistes, les interprète et les traduit dans le cadre qui est le sien, mais bien que l’anarchisme offre ces éléments, il n’a jamais formulé une définition de l’anarchosyndicalisme. C’est dans le sein de cette structure syndicale qu’à maintes reprises on a insisté sur une telle définition, surtout pour le différencier d’un certain syndicalisme révolutionnaire brandi par certains partis politiques marxistes, sans que ce désir de se différencier ait pu empêcher l’introduction d’éléments déformateurs.
Nous croyons que la substance anarchiste du syndicalisme ne doit pas être figée par une définition, mais que cette substance doit se signifier par l’orientation et le contenu de son action.
2. Impasse du syndicalisme
Lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, sont acceptées par le Système les plus importantes revendications syndicales (sécurité sociale, droit du travail, reconnaissance du syndicat de la part de l’entreprise) qui jusqu’aux années 30 étaient partiellement, mais non universellement reconnues, toutes les grandes organisations syndicales restent, volontairement, intégrées dans le système en tant qu’institutions indispensables pour son engrenage.
D’autre part le processus de négociation des conventions collectives, en particulier dans le secteur industriel, étant soumis à la régulation, à la codification et aux ordonnances de l’Administration gouvernementale – préalablement promulguées par le Pouvoir législatif – il constitue un des éléments les plus importants, voire indispensable, pour le développement de l’exploitation capitaliste. Les syndicats, en acceptant ledit processus de négociation, facilitent le perfectionnement de l’exploitation des travailleurs.
Le syndicalisme, en s’institutionnalisant, a perdu sa liberté d’action et il a cru la compenser avec une prétendue sécurité sociale et de l’emploi.
Le « licenciement arbitraire » (avec lequel le travailleur perd le droit et la garantie de son poste de travail), la croissante « économie immergée » (moyennant laquelle le patronat escamote le versement des taxes destinées aux prestations sociales des travailleurs) et finalement, la reconversion technologique dont la doctrine est l’augmentation du rythme et du volume de la production et la réduction des postes de travail, sont, fondamentalement, les facteurs qui déterminent l’irrésistible croissance d’une tendance à l’insécurité de l’emploi et à l’insécurité sociale dans les relations de production.
Comme cela peut se vérifier dans ce processus de rigoureuse intégration, le syndicalisme perd sa liberté d’action ainsi que la possibilité de défendre véritablement la sécurité du travail et la sécurité sociale des travailleurs.
Dans ce processus d’intégration s’est développée une contradiction absolument antagonique et irréversible. En effet, les membres qui composent l’appareil syndical sont gratifiés par le Capital et par l’État d’un statut privilégié par rapport au reste des travailleurs, ce qui est le début d’un processus largement développé de soumission de ceux-ci aux appareils. Les structures directes des travailleurs (les syndicats) perdent ainsi leur rôle de protagoniste.
Les « appareils » se substituent au mouvement syndical et l’option révolutionnaire du mouvement ouvrier organisé syndicalement est, une fois de plus, neutralisée. C’est dans ce cadre d’indéniable impasse du syndicalisme, en tant qu’option révolutionnaire, que doit s’analyser le rôle de l’anarchosyndicalisme, seule proposition d’action ouvrière qui résiste à l’intégration.
À ce propos, la première observation critique qui doit être faite est celle d’une organisation anarchosyndicaliste qui centrerait son action sur l’amélioration des revendications syndicales (élargissement des couvertures sociales, baisse de l’âge de la retraite, diminution de la journée de travail, augmentation du temps de repos, extension de tous les avantages aux secteurs discriminés, etc.), c’est-à- dire dans un élargissement et un perfectionnement de l’application et du fonctionnement des revendications qui ont contribué à un plus grand raffinement de l’exploitation.
L’anarchosyndicalisme se débat donc dans un cercle qui l’enferme: il est impuissant pour avancer vers les finalités de transformation sociales, il continue à être affronté et confronté à l’intégration, en même temps qu’il préconise l’extension et le perfectionnement de revendications qui, objectivement ont facilité l’intégration dans le système du mouvement ouvrier organisé syndicalement. L’impasse de l’anarchosyndicalisme est, elle aussi, indéniable.
Croire que l’impasse du syndicalisme collaborationniste facilite l’essor de l’anarchosyndicalisme est une erreur; l’impasse révolutionnaire de celui-là déclenche un phénomène d’entraînement qui nuit globalement au mouvement syndical.
Mais il est indu de parler de la crise du syndicalisme sans la mettre en rapport avec la crise générale de toutes les institutions et courants de la société civile. Crise qui provoque le même « phénomène d’entraînement » et qui atteint tout le corps social, y compris les organisations, entités et courants anarchistes.
Les critiques anarchistes du syndicalisme devraient se demander si celui-ci est la cause de la crise révolutionnaire, ou tout simplement si son impasse n’est qu’un effet d’une crise générale, qui comprend aussi la crise de l’anarchisme.
3. Nécessité d’une structure anarchosyndicaliste
Malgré l’impasse actuelle, malgré les contradictions et les insuffisances qui se sont manifestées au sein de l’organisation anarchosyndicaliste tout au long de son histoire, on doit rejeter résolument l’idée de sa déstructuration.
L’essor des divers courants de l’anarchisme a eu besoin et continue à avoir besoin d’une organisation vertébrée, stable, capable de catalyser l’action de toutes les options qui se manifestent dans l’anarchisme.
Parmi toutes les organisations que le mouvement a connues, aucune n’a mieux couvert ce besoin que l’anarchosyndicalisme. Là où le discours anarchosyndicaliste ne s’est pas traduit dans une organisation influente, l’anarchisme n’a fait que végéter. Il est vrai que la fonction catalysatrice de la structure anarchosyndicaliste est aujourd’hui constamment mise en question, mais aucun discours issu du mouvement libertaire n’a proposé la création d’une structure capable de remplir cette fonction. La vertébration organique des Fédérations anarchistes (auxquelles, bien entendu, nous ne nous opposons pas) ne peut en aucun cas être considérée comme substitutive de cette fonction de catalyseur; tout du moins, elle ne l’a pas encore démontré.
D’autre part, et pour répondre à tous ceux qui estiment qu’il n’y a pas besoin d’une organisation structurée, on n’a qu’à se référer aux processus historiques et aux actuels phénomènes sociaux affinitaires, par lesquels se vérifie combien l’anarchisme est inopérant lorsqu’il souffre de l’absence d’une organisation capable de servir de catalyseur.
Si la structure de l’anarchosyndicalisme ne remplit plus cette fonction, il faudra créer une autre forme de structure, mais les critiques ne l’ont pas encore trouvée. Nous croyons donc nécessaire de maintenir l’organisation anarchosyndicaliste.
4. Perspectives de l’anarchosyndicalisme
En fonction d’autres définitions possibles et en donnant une portée non limitative aux influences et perspectives qui peuvent découler de l’organisation syndicale, on peut penser à une action trans-structurale et extra-syndicale en opposition avec une vision simple et exclusivement structurale de l’action syndicale. Pour démontrer les effets incompatibles entre les deux positions, nous allons nous référer à deux faits historiques (parmi tant d’autres) :
1° le 19 juillet 1936, lorsque se produit en Espagne le soulèvement militaire, la CNT aurait été incapable de le faire avorter si elle n’avait compté qu’avec sa structure organique; cela fut possible (en particulier en Catalogne) parce qu’elle avait à ses côtés les secteurs populaires, non intégrés dans aucune structure, mais qui avaient subi l’action trans-structurale et extra-syndicale de la CNT pendant plusieurs années ;
2° à partir du 21 juillet 1936, les organes représentatifs 23 de la CNT se trouvent soumis à un rythme infernal de réunions, Plenarias * et Plenos *, à tel point que les syndicats ne peuvent pas suivre ce rythme sans de sérieuses difficultés de fonctionnement le fédéralisme se fendille, produisant une coupure entre les syndicats et les organes fédéraux et confédéraux, qui pèsera lourdement sur les orientations politiques de la CNT. Il se déclencha ainsi une action intra-structurale des organes représentatifs qui, sans doute, facilita le chemin vers la participation de la CNT au Gouvernement. Dans ce cas, particulièrement limite, se manifeste un phénomène intra-structurel, auquel tend toute organisation quand ses organes représentatifs ne sentent plus la pression de ceux qu’ils représentent.
Aujourd’hui, plus que jamais, alors que le syndicalisme se trouve dans une impasse indéniable, il est nécessaire que la structure anarchosyndicaliste développe une action trans-structurale, extra-syndicale et toujours contre-institutionnelle.
A. – Trans-structurale
L’objectif fondamental et prioritaire de l’action anarchosyndicaliste doit être d’intervenir dans la situation des secteurs non institutionnalisés (non intégrés à aucune structure syndicale), chaque jour plus nombreux (chômeurs, coopérativisme nouveau et marginal, conflits « sauvages » des travailleurs, sous-secteurs de la production discriminés par « l’économie immergée », etc.).
Même si cela semble paradoxal, on doit éviter de jouer un rôle de protagoniste orienté vers l’intégration dans l’anarchosyndicalisme de tous ces secteurs et sous-secteurs; celle-ci doit être une option libre et volontaire à laquelle on doit accéder sans pressions.
B. – Extra-syndicale
L’action extra-syndicale est une façon d’intervenir dans l’activité des mouvements sociaux, culturels, marginaux, dont le signe anti-autoritaire leur donne une orientation anarchisante.
Établir avec ces mouvements des relations d’action d’ensemble, non structurale, en refusant la prétention erronée, visée en Espagne en 1976-77, d’une « CNT globaliste », c’est-à-dire une structure dans laquelle trouveraient leur place, à côté des syndicats, les Athénées, les collectifs, les groupes, les communes, etc.; nous considérons inadéquate une telle intégration car elle introduirait au sein de l’organisation anarchosyndicaliste un élément de dé-structuration.
Ce qui est structural et ce qui est a-structural doit jouir d’une autonomie complète dans son fonctionnement respectif; le « pacte fédéral », dans lequel se développe l’organisation anarchosyndicaliste n’est pas applicable à la caractéristique a-structurale dans laquelle se développent ces mouvements; ces deux formes ne peuvent être liées que par un « pacte d’action ».
C. – Contre-institutionnelle
La présence et l’action de l’anarchosyndicalisme sont nécessaires comme pression constante sur les macrosecteurs ouvriers intégrés, rompant les schémas institutionnalisés dans lesquels ils évoluent. La méthode d’action est l’intervention lors d’agitations, de manifestations, grèves, conflits et négociations, débordant les « appareils » et organismes syndicaux institutionnalisés.
Toute prétention d’introduire des initiatives qualitatives dans le cadre institutionnel, en acceptant de participer à ses mécanismes, est pure illusion. La seule initiative qualitative est de rompre ledit cadre. Au Comité d’entreprise institutionnel, on doit opposer les « délégués d’entreprise », on doit opposer les représentants mandatés par l’assemblée des travailleurs.
Les assemblées de travailleurs (d’entreprise ou dans le secteur de l’industrie) peuvent, il est vrai, prendre dans certaines occasions des décisions en contradiction avec les accords généraux de l’organisation anarchosyndicaliste, mais faire appel à l’assemblée n’est pas seulement un acte ponctuel mais aussi un processus constant de régulation et de rectification des relations entre les travailleurs; malgré les contradictions qui peuvent surgir dans ces situations, l’anarchosyndicalisme peut participer avec de meilleures et de plus amples possibilités dans le cadre institutionnel.
* Formes de réunions générales représentatives et caractéristiques du mode de fonctionnement de la C.N.T. (note de la trad.)
Catégories :Anarcho-syndicalisme, Journal Liberté Ouvrière, Organisations





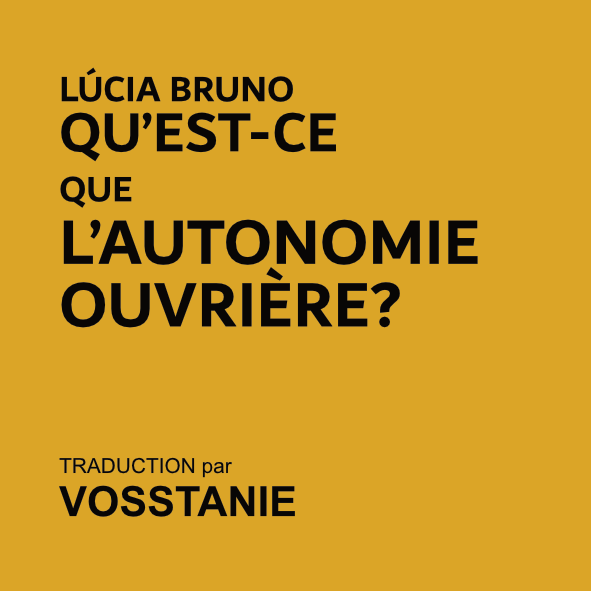

1 replies »