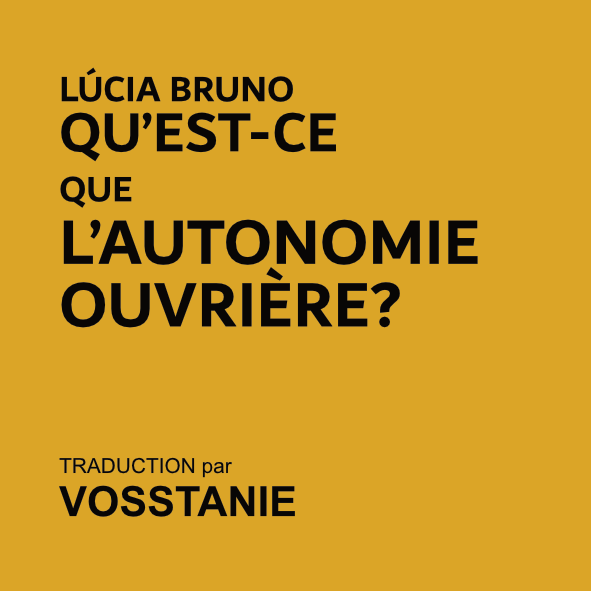En savoir plus sur cette photo sur France Culture
Vu de France, il est difficile de ne pas évoquer l’Algérie, tant les deux pays sont connectés l’un à l’autre par l’histoire, la géographie, l’économie, la culture… Cette « relation spéciale » s’illustre notamment par le fait que la principale communauté d’étrangers en France est composée par les centaines de milliers de ressortissants algériens, sans compter les citoyens français et binationaux dont un parent ou plus sont originaires de l’ancienne colonie. Si ces individus alimentent bien des fantasmes, souvent à leur corps défendant, ils restent pour l’essentiel des boucs-émissaires désignés à la vindicte réactionnaire.
Dans le cadre de leur croisade xénophobe, la droite et l’extrême droite dénoncent régulièrement l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui était censé réguler le séjour des travailleurs algériens en France. Ces attaques récurrentes n’ont pas d’autre but que de remettre en cause la légitimité de la présence des ressortissants algériens et de leurs enfants, composante dynamique des classes populaires. Comme si les réactionnaires n’avaient toujours pas digéré l’indépendance de leur ancienne possession en 1962. Le nouveau ministre de l’Intérieur, le très droitier Bruno Retailleau, s’inscrit résolument dans cette tradition puisqu’il a déclaré, le 29 septembre sur LCI, que ce traité bilatéral est « déséquilibré, extrêmement avantageux pour l’Algérie et très désavantageux pour la France ». Ce qui revient à dire qu’il y aurait non seulement trop d’immigrés en France mais surtout trop d’Algériens selon lui… Sans surprise, le porte-parole du gouvernement a annoncé, le 13 octobre, qu’une nouvelle loi sur l’immigration serait nécessaire en 2025. Pour rappel, en septembre 2023, Bruno Retailleau – qui était alors sénateur – avait évoqué les « belles heures » de la colonisation, tout en fustigeant « l’esprit de repentance ». Aujourd’hui, le ministre prône « une politique de fermeté vis-à-vis de l’immigration », ce qui n’augure rien de bon pour ce segment du prolétariat mais aussi, plus largement, pour l’ensemble de la population laborieuse à qui le gouvernement de Michel Barnier n’a rien d’autre à offrir que la répression et la rigueur.
Les « guerres culturelles » françaises ont souvent pour toile de fond le rapport à l’Algérie – qu’il soit explicite ou implicite – avec, pour finalité, la stigmatisation d’un « ennemi intérieur ». Un exemple nous est donné par la campagne promotionnelle du roman de Kamel Daoud, Houris (Gallimard, 2024). Ce journaliste franco-algérien qui, dans ses chroniques publiées dans Le Quotidien d’Oran, avait jadis captivé un lectorat important en Algérie – grâce à sa verve libérale dirigée contre le dogme national – est devenu, au cours des dernières années, un des porte-voix du conservatisme hexagonal. De fait, ses éditoriaux parus dans l’hebdomadaire parisien Le Point ont accompagné la dérive droitière du pouvoir macroniste et, plus largement, des élites françaises. Dans ses interviews accordées au cours de cette rentrée littéraire, le romancier oppose deux séquences de l’histoire algérienne : la guerre de libération et la guerre civile. Ce faisant, il joue sur les fractures de la société algérienne et de la gauche française. C’était le cas lors de son entretien accordé à France Inter le 28 août : « L’Algérie propose deux histoires dont l’une est occultée. La première, c’est le récit mythologisé de la décolonisation dont tout le monde parle. L’Algérie, c’est un peu le pays de La Bataille d’Alger, en noir et blanc, etc. Mais la seconde leçon que l’on a toujours voulu ignorer, c’est le coût de l’islamisme armé, qu’est que cela coûte cette illusion, cette utopie ravageuse et qui massacre. »
En effet, les progressistes sont plus enclin à évoquer le moment colonial afin d’interroger son legs, notamment la persistance du racisme dans la société française. Des dates-clés de la guerre de libération algérienne – ou révolution anticoloniale, qui a pris la forme d’une lutte armée contre le colonialisme, entre 1954 et 1962, pour obtenir l’indépendance – font l’objet de commémorations, comme celle du 17 octobre 1961, soutenue par des intellectuels et militants de gauche, afin de rappeler le massacre d’Algériens perpétré par la police parisienne et réclamer sa reconnaissance par les autorités françaises. Cette démarche est tout à fait compréhensible et louable. Cependant, elle s’accompagne chez certains d’une idéalisation du nationalisme algérien dont le caractère autoritaire est occulté, bien loin des analyses dialectiques qui pouvaient encore se faire entendre au cours du siècle dernier chez les anticolonialistes ou leurs héritiers (libertaires, marxistes, etc.). En outre, la résurgence d’un tiers-mondisme 2.0 (où l’optique « socialiste » des origines est remplacée par un discours identitaire) entrave souvent la critique de la dictature algérienne, comme l’atteste le silence quasi-général face à la réélection d’Abdelmadjid Tebboune, le 7 septembre, avec le « score soviétique » de 84,3 % au premier tour. Une illustration stéréotypée mais significative de cette tendance nous est donnée par l’eurodéputée d’origine palestinienne Rima Hassan. Après un séjour à Alger, l’élue de La France insoumise (LFI) a répondu à l’essayiste pro-israélien Raphaël Enthoven en postant le 9 juillet sur X : « La Mecque des révolutionnaires et de la Liberté est et restera l’Algérie. Tel Aviv est la capitale d’un régime fasciste et d’un État d’apartheid. »
À l’inverse, la guerre civile algérienne – qui a opposé, durant les années 1990, des groupes islamistes armés aux forces de l’ordre, au prix de plusieurs centaines de milliers de victimes – est un sujet beaucoup plus sensible à aborder au sein de la gauche française. Sans doute parce que les événements restent encore trop proches. De plus, de nombreux Algériens, protagonistes ou victimes, se sont installés en France, emportant avec eux leurs traumatismes et leur perception de cette tragédie. Enfin, ce conflit « algéro-algérien » – à l’origine, puisque des attentats ont été perpétrés sur le sol français – a aussi opposé diverses factions hexagonales (intellectuels, militants, de droite comme de gauche, mais aussi des secteurs de l’appareil d’État) pour désigner « l’ennemi principal » : s’agissait-il du régime militaro-policier ou des insurgés islamistes ? Ce qui avait pour conséquence de soutenir de façon plus ou moins inconditionnelle un camp plutôt qu’un autre et de s’aveugler sur les exactions du premier (tortures, enlèvements, répression…) ainsi que sur les atrocités du second (attentats, massacres, viols…). Les leçons de la « décennie noire » n’ont pas été retenues. Pourtant, les clivages de la guerre civile algérienne ont servi, en grande partie, de matrice aux controverses françaises sur la question musulmane, en mobilisant les mêmes intervenants (ou leurs disciples), même si quelques « transfuges » ont préféré changer de camp, dans une démarche sincère ou par pur opportunisme.
Mais la volonté d’opposer, de façon détournée ou assumée, ces deux séquences algériennes dans les débats français nous en dit long sur le rapport instrumental à l’histoire et sur l’évolution du rapport de force entre la droite et la gauche. Cette démarche indique le sens des priorités pour les conservateurs qui donnent le ton dans les champs médiatique, éditorial et politique. De fait, il s’agit selon eux d’affirmer que l’urgence ne serait ni les crimes coloniaux ni le problème du racisme – et encore moins la question sociale –, mais bien plutôt la « menace islamiste » et, par capillarité, le « problème musulman », la « crise migratoire », etc. Ce qui, à leurs yeux, devrait conduire à la défense d’une « Europe forteresse », à l’affirmation de « l’identité nationale », à l’expulsion des étrangers – baptisée « remigration » – et au déni face aux discriminations subies par des pans entiers de la population dans leur accès au logement, aux études, à l’emploi, aux loisirs… Il est vrai que certains représentants de la gauche française ne font pas toujours preuve de clarté ou de cohérence sur de nombreux sujets sensibles. Cependant, il ne faut pas se tromper d’ennemi. Surtout quand l’extrême droite est aux portes du pouvoir… Encore faut-il situer les responsabilités et ne rien céder au défaitisme. Ce qui revient aussi à poser les questions qui fâchent, même si cela n’est jamais payant à court terme, et à sortir des sentiers battus où se promènent les spectateurs du désastre.
De nombreuses personnalités d’origine algérienne se trouvent des deux côtés de la barricade dans ces « guerres culturelles » qui déclinent, pour le contexte hexagonal, des controverses élaborées au plan international mais qui ne sont, au bout du compte, qu’un avatar de la guerre des classes que mène avec férocité la bourgeoisie française. C’est sous cet angle que les polémiques récurrentes doivent être comprises. En effet, quand elle ne crée pas de toute pièce des fractures dans la société, et plus particulièrement au sein des couches défavorisées, la propagande les aggrave en déplaçant l’attention sur des problématiques qui désarçonnent et créent un maximum de confusion. Dans cette configuration, les journalistes, écrivains ou intellectuels à la solde du pouvoir jouent leur partition, à grand renfort de publicité.
Kamel Daoud, né à Mostaganem en 1970 et naturalisé français en 2020, est donc une figure de cette « diversité » réactionnaire en dénonçant régulièrement la « propagande islamiste, woke ou décoloniale ». Nous pouvons citer Boualem Sansal, auteur du Serment des barbares (Gallimard, 1999). L’écrivain, né à Theniet el Had en 1949 et récemment naturalisé français, a rejoint le comité stratégique du média identitaire Livre noir/Frontières. Cet ami de Kamel Daoud fustige « l’islamisme, le wokisme et le consumérisme », en reprenant la rhétorique catastrophiste et décliniste d’Eric Zemmour. Mohammed Sifaoui fait aussi partie de ces voix privilégiées par les conservateurs pour traiter de l’islamisme. Né dans la banlieue algéroise en 1967, ce journaliste naturalisé français s’est d’ailleurs spécialisé dans ce domaine depuis la guerre civile algérienne, en ciblant notamment « l’islamo-gauchisme », sans rigueur ni nuance… Ces trois témoins de la « décennie noire » simplifient les enjeux d’une séquence traumatisante pour proposer un récit compatible avec celui du « choc des civilisations ». Mais les femmes ne sont pas en reste. Rappelons que Malika Sorel se trouvait en deuxième position sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes de juin 2024. Cette essayiste, née Halima Mayouf en 1960 à Marseille, est diplômée, comme Boualem Sansal, de l’École nationale polytechnique d’Alger. L’énumération pourrait se poursuivre avec Lydia Guirous, née en 1984 à Tizi Hibel et ancienne porte-parole du parti Les Républicains, ou avec Fatiha Agag-Boudjahlat, née en 1979 à Montbéliard et cofondatrice de Viv(r)e la République.
Il serait tentant de les réduire au rôle d’« informateurs indigènes » ou de « cautions exotiques » permettant à la droite (extrême) française de se dédouaner de l’accusation de racisme en raison de leur origine, tout en véhiculant dans les médias un discours hostile à l’islamisme voire, par amalgames successifs, à l’islam, aux musulmans ou aux immigrés… Or, cela empêcherait de penser que leur simple présence manifeste avant tout l’attractivité du « mode de vie français » – par contraste avec leur pays d’origine – dans la mesure où ces individus ont fait leur choix au plan national, en ayant opté pour la citoyenneté française (du moins chez ceux nés en Algérie) ou en se faisant les vecteurs assumés du chauvinisme hexagonal. En effet, leur discours souvent caricatural épouse des valeurs conservatrices (autorité, hiérarchie, mérite, sécurité, etc.), également portées par certains éléments de la diaspora algérienne – qui est loin de constituer un bloc homogène. De plus, en abusant de notions dévoyées ou chargées idéologiquement (assimilation, laïcité, universalisme, etc.), ils contribuer à interpréter les « valeurs de la République » comme autant de raisons d’exclure les prolétaires immigrés ou leur descendance, plutôt que de les inclure sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la société. Pourtant, en dépit de leur « réussite » personnelle, ces individus s’inscrivent, bon gré mal gré, dans l’histoire longue de la gestion impériale des minorités puisqu’ils demeurent des subalternes cantonnés à un domaine spécifique.
En raison de l’influence du pôle éditorial et médiatique détenu par les conservateurs – le groupe Bolloré en est l’exemple le plus connu mais il est loin d’être le seul –, les progressistes font donc pâle figure en France, d’autant que les thèmes promus par leurs adversaires sont rarement ceux qu’ils privilégient. De plus – ruse de la raison inclusive –, la « diversité » comme la « parité » paradoxalement incarnés par les réactionnaires franco-algériens contribuent à désarmer la gauche qui plébiscite, de son côté, l’antiracisme et le féminisme, tout en traînant comme un boulet un vieux contentieux avec la diaspora algérienne. Cette histoire centenaire de mépris ou de méprises masque toutefois des rencontres fructueuses même si les directions des principales organisations du vieux mouvement ouvrier – empêtrées dans le bureaucratisme, le clientélisme et le nationalisme – ont rarement été à la hauteur concernant les enjeux relatifs à la lutte contre l’impérialisme ou les discriminations. Ce passif a pu conduire des réformistes ou révolutionnaires, désormais affaiblis, à éviter les sujets qui divisent et à promouvoir des figures autrement caricaturales que celles portées aux nues par la droite, tout en se situant sur un plan analogue – celui de l’identité ou de la « race » – malgré leur opposition symétrique. Par conséquent, ces « ennemis complémentaires » entravent, volontairement ou non, l’émergence de discours ou de pratiques qui s’inscrivent dans une perspective libertaire, en les rendant inaudibles, en particulier quand elles émanent d’individus que l’on appelle désormais « racisés ». C’est la double peine.
Le malaise de la gauche française face au souvenir de la guerre civile algérienne traduit l’ambiguïté, pour ne pas dire davantage, de certains de ses éléments à l’égard de l’islam politique qui ont fait les yeux doux au Front islamique du salut (FIS) algérien, au Hamas palestinien, au Hezbollah libanais ou au prédicateur Tariq Ramadan, petit-fils de Hassan el-Banna, fondateur des Frères musulmans en Égypte. Un exemple récent nous est donné par le soutien apporté, en septembre, par la députée LFI Ersilia Soudais à l’influenceur salafiste El Yess Zarelli alias Elias d’Imzalène, ancien compagnon de route du fasciste Alain Soral, qui a appelé à « mener l’intifada dans Paris ». Précisons que cette démarche n’a pas fait l’unanimité, loin de là. Mais, pour faire bonne mesure, il convient de rappeler l’ambivalence – pour ne pas aller plus loin – de certains de ses représentants à l’égard du régime militaro-policier algérien. En effet, durant la période du parti unique (de 1962 au soulèvement d’octobre 1988), les autorités nouvellement indépendantes ont pu compter sur le soutien d’organisations et de publications françaises qui, de manière désintéressée ou non, se sont abstenues, la plupart du temps, de dénoncer la répression ou de critiquer le gouvernement algérien dont ils partageaient les vues « anti-impérialistes ». C’était le cas du Parti communiste français (PCF), du Parti socialiste unifié (PSU), du Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM), du quotidien maoïste L’Humanité rouge ou d’autres organes tiers-mondistes. La collusion de fractions de la gauche autoritaire avec des régimes despotiques – « l’anti-impérialisme des imbéciles » – s’est manifestée depuis dans les cas de la Syrie ou de l’Iran.
Occulter le jeu des États – algérien et français, pour commencer – ne permettrait pas de rendre pleinement compte de cette « relation spéciale » et de ses conséquences. Mais cela nécessiterait de plus amples développements afin d’éviter les biais conspirationnistes des contempteurs de la « Françalgérie ». Tout au plus peut-on souligner ici le poids des administrations qui alimentent un nationalisme exclusif, plaçant les binationaux dans des conflits de légitimité, conduisant à des changements d’allégeance selon les contextes, plaçant en certaines occasions quelques individus dans une situation favorable, pour mieux abandonner la majorité à son triste sort. Si le choix des couleurs à agiter constitue une bien maigre consolation pour les couches exploitées – dans la mesure où cela ne répond en rien à leurs aspirations fondamentales –, le chauvinisme n’en demeure pas moins une arme décisive aux mains de la classe possédante qui a les moyens de s’attacher les services de mercenaires de la plume, qu’ils soient franco-algériens ou non, motivés à l’idée de distiller leur poison dans les consciences, moyennant argent, pouvoir et succès. Ce faisant, les dignitaires de l’intelligentsia réactionnaire agissent comme des convertis ou des fonctionnaires zélés, toujours prêts à obéir à la raison d’État – comme les bureaucrates se soumettent à la raison du parti qui ne saurait se tromper –, quitte à se vendre au plus offrant, et trahir au passage les convictions qu’ils avaient prétendu défendre sur d’autres champs de bataille.
Cependant, en guise de conclusion, revenons au rôle des forces que l’on associe, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, à la « gauche ». Car les réformistes et les révolutionnaires ne sont pas condamnés à répéter éternellement les mêmes erreurs en attendant la prochaine catastrophe. De la même façon, les défaillances ou tergiversations de quelques-uns ne doivent en aucune manière servir de prétexte à la disqualification, en bloc, des forces progressistes pour mieux rallier le camp réactionnaire, susciter des polémiques stériles – car ne proposant ni dépassement dialectique dans la théorie ni perspective émancipatrice dans la pratique – ou alimenter la passivité, ce qui aboutit à un résultat identique : la défaite dans le ressentiment. C’est une voie sans retour possible, indépendamment du vernis dont on pourrait la recouvrir… Au cours des luttes contre le colonialisme, contre la dictature de parti unique, contre le racisme, durant la guerre civile, après la dernière vague d’attentats en France, comme depuis la crise ouverte par le 7 octobre dernier, il s’est toujours trouvé des éléments, même isolés, qui, de part et d’autre de la Méditerranée – et bien au-delà –, ont refusé avec lucidité l’intégrisme, le nationalisme et le sexisme, pour faire vivre, au sens plein du terme, l’internationalisme, le pluralisme et la solidarité. Il nous revient donc de puiser dans ce que notre histoire a de meilleur pour imaginer avec optimisme des futurs désirables. C’est là le défi de notre temps.
Enfin, à l’heure où les populations libanaises, palestiniennes, soudanaises ou ukrainiennes se font quotidiennement bombarder, il est impossible de détourner le regard et d’affirmer que cela ne nous concerne pas. Contre le colonialisme et la guerre, là-bas, contre l’exploitation et le racisme, ici, c’est le même élan humaniste et révolutionnaire qui doit conduire à condamner avec la plus grande force les abominations qui nous aviliraient définitivement si nous nous risquions à les banaliser en recourant à une rhétorique pétrie de cynisme et de préjugés ou, pire encore, à les cautionner sous quelque motif que ce soit – car cela aboutirait à consacrer le triomphe des croisades réactionnaires dans leur entreprise de déshumanisation de l’Autre à des fins d’éradication pure et simple. Hier comme aujourd’hui, « pas de choix entre les victimes ! » C’est aussi une question de principe, surtout pour ceux qui ne désespèrent pas de voir le monde changer de base.
Paris, le 15 octobre 2024
Catégories :Afrique, Anti-racisme, Conflit armé, Europe, Extrême-droite, France, Géopolitique, Guerre, Histoire, Luttes populaires, nationalisme, Répression, Texte